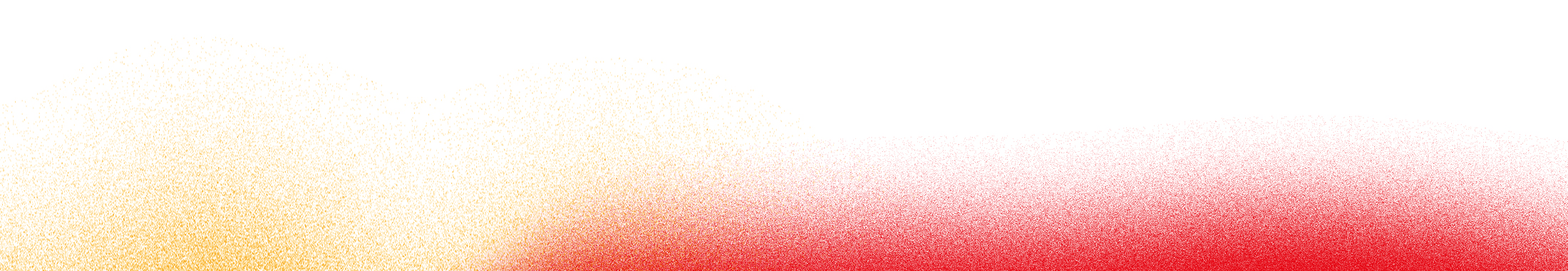Les Franches-Montagnes célébrées par les peintres jurassiens
Jacques-Henri Juillerat
Le Moulin de la mort, vers 1820
Aquarelle sur papier, 33 x 22 cm
Inv. 824
Collection jurassienne des beaux-arts, Porrentruy
A. Lenz
Village des Bois, après 1856
Huile sur toile, 36 x 55 cm
MJ.1996.80
Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont
Jean-Louis Jobin
Sous-le-Bémont, 1936
Huile sur toile, 45 x 80 cm
Inv. 941
Collection jurassienne des beaux-arts, Porrentruy
Pierre Michel
La rentrée des chevaux, 1969
Lithographie, 50 x 62 cm
Inv. 893
Collection jurassienne des beaux-arts, Porrentruy
Jacques-Henri Juillerat, né à Moutier en 1777, est l’un des premiers artistes jurassiens à s’intéresser aux paysages des Franches-Montagnes en peinture. Si sa santé fragile ne lui permet pas de gravir les montagnes alpines comme ses contemporains, il excelle dans la représentation de la campagne jurassienne autour des années 1820. Aquarelliste de talent, il réalise dans « Le Moulin de la mort » l’une des plus anciennes vues des Franches-Montagnes connue aujourd’hui, marquée par la présence des fameux sapins qui apparaissent sur la rive gauche du Doubs.
Dans la peinture de cette époque, le paysage n’est pratiquement jamais seul, il est toujours accompagné d’un élément architectural retenu pour sa valeur historique ou légendaire, tel qu’une église, un château ou un moulin. Dans l’aquarelle de Juillerat, l’architecture occupe un espace secondaire. Ce qui l’intéresse, ce sont les falaises et le caractère accidenté du lieu. À l’époque romantique, les artistes privilégient les cluses profondes du Jura plissé plus que les pâturages boisés et les vastes horizons du haut-plateau.
Dans la seconde partie du 19e siècle, on peut regretter que la peinture réaliste ne se soit pas développée sur les terres du haut-plateau. « Paysage du Jura », de Gustave Courbet, appartient bien à cette époque (1872), mais le lieu n’a pas été identifié, malgré les nombreuses recherches menées ces dernières années. Il convient de citer A. Lenz, un personnage peu connu, qui a représenté un très charmant village des Bois avec une scène de travail des champs, après 1856.
En effet, les Franches-Montagnes sont tardivement touchées par cette nouvelle sensibilité des peintres à l’égard de la nature et de la vie rurale. Sans oublier les pastels du Doubs du Neuchâtelois Charles L’Eplattenier réalisés vers 1915, c’est au milieu du 20e siècle seulement, sous l’impulsion d’Albert Schnyder et de Coghuf que les paysages franc-montagnards prennent un essor important sous les pinceaux de nombreux peintres jurassiens, comme Fritz Boegli, Laurent Boillat (en graveur plus intimiste), Serge Voisard, Jean-Louis Jobin, Pierre Michel, Walter Bucher, Roger Voser ; puis Yves Voirol, Sylvère Rebetez, Roger Tissot et René Fendt qui donnent parfois naissance à des paysages proches de l’abstraction.
L’iconographie du haut-plateau se définit alors par trois éléments essentiels : la ferme, le sapin et le cheval. « La rentrée des chevaux » de Pierre Michel est un paysage typique de ce style figuratif qui renaît chez une dizaine d’artistes jurassiens épris de leur région, tandis que d’autres semblent davantage attirés par la peinture non figurative. Sur un format oblong (parfois beaucoup plus marqué dans ses huiles), les caractères habituels des compositions de Pierre Michel sont aisément identifiables : une ferme imposante, une terre haute, une zone boisée sombre et un ciel bas. Les chevaux occupent naturellement le premier plan, puisqu’ils sont les protagonistes de la scène.
Au 21e siècle, les artistes inspirés par la nature contrastée des Franches-Montagnes reviennent en force. Leur langage prend toutefois des libertés face au modèle et devient plus personnel, comme chez René Myrha, Sylvie Aubry ou Marcel-André Droz, par exemple.
Pour aller plus loin
Christine Salvadé, Ferme, sapin, cheval. Une étude iconographique du paysage des Franches-Montagnes, Université Lausanne, 1991.