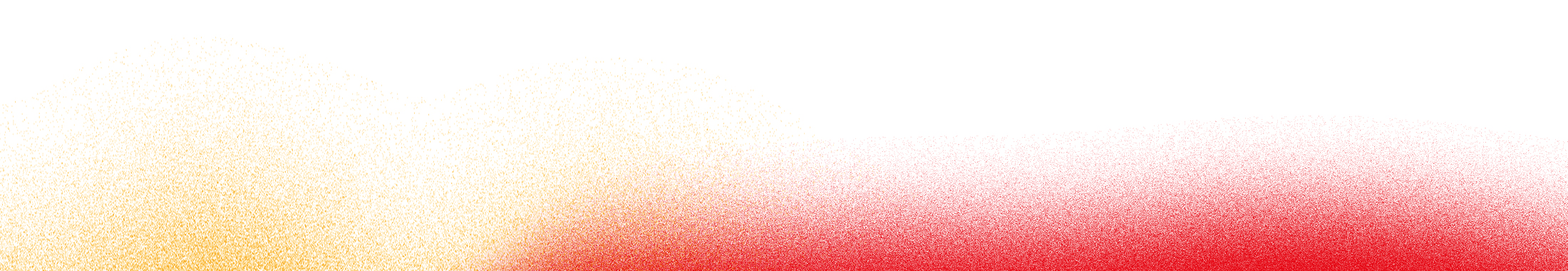Eugène Cattin, Ferme et petit atelier de monteur
Passé
Eugène Cattin
Ferme et petit atelier de monteur de boîte, 6/9 Sous-la-Velle, Le Noirmont, 1900-1910
Retirage d’une plaque de verre, 9 x 12 cm
ArCJ 137 J 1545 a
Archives cantonales jurassiennes, Porrentruy
Présent
Julien Ogi
Sans titre, 2024
Photographie
Photo-club des Franches-Montagnes
Paysage horloger
Défrichées tardivement, les Franches-Montagnes ont longtemps présenté un aspect austère, dû à une pauvreté endémique. Regroupés autour d’un noyau invariablement constitué de l’église, de la cure et du cimetière, les villages de la région comprenaient de nombreuses métairies, ainsi que des fermes isolées, parfois implantées à proximité d’une source ou d’un étang.
Ce pays n’avait pas été épargné par les guerres et les épidémies. Aussi, après un XVIIe siècle calamiteux, l’apparition de l’industrie horlogère vers 1700 fut accueillie avec soulagement par la population. Dès 1850, la morphologie de ses villages s’en trouva modifiée. Des immeubles locatifs, ainsi que des ateliers surgirent de terre. Actuellement, en particulier au Bois, aux Breuleux, au Noirmont ainsi qu’à Saignelégier, des usines monumentales - de réputation internationale - emploient une main d’œuvre hautement qualifiée, occupée notamment dans les secteurs de l’habillage horloger (boîtes et bracelets de montres), de la conception/réalisation/assemblage de mouvements d’horlogerie, ainsi que dans la fabrication de produits dérivés (bijouterie, maroquinerie).
Boîtiers, horlogers, paysans…
Le « paysan-horloger » : réalité ou légende urbaine ? Servant de lien entre autarcie rurale et civilisation industrielle, le « paysan-horloger » appelle un éclairage historique nuancé. L’agriculture renvoie aujourd’hui aux professionnels de la culture et de l’élevage. Il n’en va pas de même du « paysan », qui se réfère à un monde oublié, peuplé de petits artisans (forgerons, tourneurs sur bois ou sur métal, meuniers, tisserands, teinturiers, dentelières) pour qui le « train de ferme » n’était pas un choix mais une nécessité alimentaire. Pas de grande distribution à l’époque ; on vivait uniquement de ce qui était produit ou fabriqué dans un rayon régional. Le XVIIIème siècle nous apportera l’horlogerie, qui mettra tout de même plus de 150 ans pour supplanter les usages ancestraux. Cette même horlogerie attirera dès après 1880 les premiers magasins, qui étoufferont toute velléité d’autarcie. Elle introduira une certaine aisance pécuniaire, créant ainsi un besoin de confort et de vie associative (chorales, fanfares, sociétés sportives).
Métropole boîtière
Au milieu du XIXème siècle, sous l’influence conjuguée du chemin de fer (= ponctualité) et de la télégraphie (= heure unifiée), la montre devient indispensable. Pour satisfaire à la demande, beaucoup d’entreprises se créent. Après 1890, la force et la lumière électrique apportent sécurité et efficacité dans les usines, multipliant la production par dix. A l’aube du XXème siècle, on dénombre plus de monteurs de boîtes or, argent ou métal au Noirmont (1900 habitants à l’époque) qu’à La Chaux-de-Fonds, qui compte alors 23'000 habitants. L’un des treize Bureaux fédéraux de contrôle des métaux précieux est ouvert au Noirmont en janvier 1884 ; il est toujours en activité.
Le Noirmont abrite depuis 2015 le « Musée de la Boîte de Montre ». Longtemps négligé, le patrimoine boîtier de la région s’est ainsi offert le premier – et le seul – musée au monde consacré à l’habillage horloger. En le visitant, vous découvrirez les singularités technologiques et esthétiques de cette profession, située à la jonction de l’art et de la haute précision.
Georges Cattin, Musée de la boîte de montre, Le Noirmont
Pour aller plus loin
Le Noirmont abrite depuis 2015 le « Musée de la Boîte de Montre ». Longtemps négligé, le patrimoine boîtier de la région s’est ainsi offert le premier – et le seul – musée au monde consacré à l’habillage horloger. En le visitant, vous découvrirez les singularités technologiques et esthétiques de cette profession, située à la jonction de l’art et de la haute précision.
Urbanisme horloger
Dès la fin du 17e siècle, l’horlogerie se développe dans l’Arc jurassien, donnant lieu au mythe du paysan-horloger qui, pendant les longs mois d’hiver, s’adonne à la fabrication de la montre, installant un établi à l’une des fenêtres de sa maison rurale.
Graduellement, cette proto-industrie, source de revenu complémentaire, devient une activité professionnelle à part entière. Se développent alors une multitude d’ateliers indépendants, hautement spécialisés, qui travaillent en réseau selon un système dit de l’« établissage ». De la fabrication des composants du mouvement à la décoration de la boîte de montre, une pléiade d’entreprises de petite taille entre donc en jeu, jusqu’à la mise en vente finale du garde-temps.
Au 19e siècle, l’essor de l’horlogerie est phénoménal. Dans les Montagnes neuchâteloises, les villes du Locle et surtout de La Chaux-de-Fonds deviennent des hauts lieux de la fabrication et de la commercialisation de la montre à l’échelle mondiale. Leur succès est tel que dans les années 1880, ces localités peinent entendre les voix qui s’élèvent en faveur d’une réorganisation de la branche et une modernisation des modes de fabrication, pour contrer, tout particulièrement, la production en série qui se développe à toute vitesse de l’autre côté de l’Atlantique.
Dans cette ère des fabriques qui s’amorce, le Jura se montre ouvert aux possibilités de la mécanisation, et devient une terre d’accueil pour les nouveaux industriels. Des usines voient le jour, permettant la concentration de la main d’œuvre, la mécanisation, et la réalisation d’éléments standardisés. L’accès à la lumière naturelle reste néanmoins essentiel pour cette industrie de précision, et les fabriques dernier cri se distinguent par leurs longues rangées de baies vitrées à chaque étage, rendues possibles par l’amélioration des techniques constructives, dont le recours croissant au béton armé. Au Noirmont, l’entreprise Detech, forte de sa maison rurale et son usine contemporaine, témoigne des différentes étapes qui ont marqué le développement de la branche horlogère et de l’architecture de ses lieux de production.
Dès l’origine, l’horlogerie, qui ne cause pas de nuisance, peut côtoyer sans difficulté les hauts lieux de la vie quotidienne. La mixité des lieux de production et des lieux de vie constitue une caractéristique principale de l’urbanisme horloger. Aujourd’hui encore, l’horlogerie s’intègre harmonieusement dans le tissu urbain du canton, rappelant la riche tradition artisanale et industrielle de la région.
Marikit Taylor