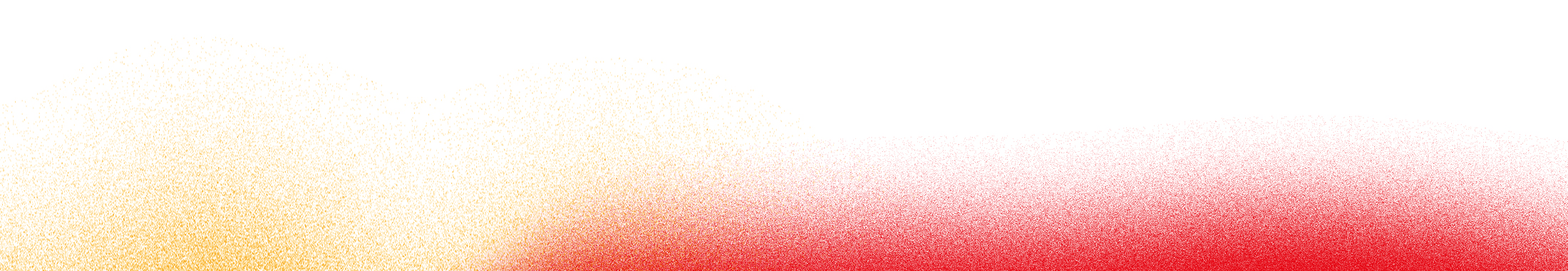Carte postale d'Epauvillers
Passé
Anonyme
Epauvillers, 1919
Retirage d’une carte postale, 9 x 14 cm
MJ.2016.46.27
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Collection Xavier Jobin, Delémont
Présent
Julien Ogi
Sans titre, 2024
Photographie
Photo-club des Franches-Montagnes
Futur
Jura-24
Sans titre, 2024
Photomontage réalisé à l’aide de Photoshop®
Où s'arrêtent les Franches-Montagnes?
Êtes-vous surpris de voir le village d’Epauvillers dans cette exposition? Pourtant, cette localité a appartenu au district des Franches-Montagnes pendant presque deux siècles! Difficile de faire l’impasse sur ce “mouvement” très spécifique qui pose la question des limites des Franches-Montagnes.
S’attacher à définir les frontières d’un territoire, voire à en retracer l’évolution dans le temps, est une tâche délicate et inconfortable, limitatrice et libératrice :
Limitatrice parce qu’elle conforte l’esprit humain dans son insuffisante capacité à englober la complexité, mais aussi toute la richesse du monde. Libératrice parce qu’elle rend possible le fonctionnement en commun et parce qu’elle devrait favoriser la construction d’une vision, d’un avenir possible avec les autres, dans un monde ouvert.[1]
Loin de n’être qu’une donnée cadastrale souvent discutée qui réduirait le sujet, la frontière telle qu’elle est perçue ici est un point de départ et non pas une fin en soi. Pour les temps passés, d’ailleurs, les sources font souvent défaut et on ne se hasardera pas à poser des jalons précis qui seraient forcément discutés. En effet, les territoires se chevauchent et les frontières politico-administratives à leurs divers niveaux (communes, sections, arrondissements scolaires) et spirituelles ne se recoupent pas toujours, sans compter que ces dernières ne sont jamais figées dans le temps. À cela s’ajoute le fait que les frontières érigées par les hommes ne se calquent pas forcément sur les limites géographiques qui ont leur importance lorsqu’il s’agit d’évoquer la circulation des idées et des hommes. Comme le rappellent Denis Duez et Damien Simonneau:
la frontière doit être envisagée comme une construction sociale, fruit de rapports sociaux et de pouvoirs, tantôt marqués par des liens de coopération, tantôt par des formes d’oppositions entre les acteurs en présence.[2]
Administrativement parlant, les frontières des Franches-Montagnes évoluent relativement peu, même si le territoire considéré n’a pas toujours les mêmes droits et la même autonomie en fonction des régimes politiques. Ses limites sont étroitement liées à la seigneurie du Spiegelberg et au territoire décrit par la charte d’Imier de Ramstein en 1384.
Les frontières sont modifiées à cinq reprises, mais sans jamais quitter véritablement le cadre géographique du haut-plateau :
en 1780, après des échanges de territoires avec la France, le Doubs devient la frontière occidentale du territoire, de la région des Bois aux portes de Soubey;
en 1815, lors de l’annexion au canton de Berne, la préfecture des Franches-Montagnes s’étend en direction du nord et gagne des terres au-delà du Doubs, notamment Epauvillers et Epiquerez;
en 1976, soit deux ans après le plébiscite du 23 juin 1974, Lajoux et Les Genevez quittent le district de Moutier pour celui des Franches-Montagnes;
en 2009, la commune de Clos-du-Doubs opère sa fusion et les localités d’Epauvillers et d’Epiquerez quittent le district des Franches-Montagnes pour rejoindre, avec la nouvelle commune, le district de Porrentruy.
Élodie Paupe, responsable du site Jura-24 des Franches-Montagnes
[1] Crevoisier Olivier, « Les régions jurassiennes et leurs frontières aujourd’hui », in : Crevoisier Clément (dir.), Atlas historique du Jura, Porrentruy : Société jurassienne d’émulation, 2012, p. 43.
[2] Duez Denis et Simonneau Damien, « Repenser la notion de frontière aujourd’hui. Du droit à la sociologie », Droit et société, no 98, 2018, p. 37.
Imaginer le futur
Les scientifiques l’affirment: les “sapins” traditionnels des Franches-Montagnes sont appelés à disparaître, comme l’explique l’éclairage ci-dessus. En nous basant sur la carte de l’institut fédéral de recherches sur la neige, la forêt et le paysage (WSL), nous proposons une vue qui intègre, au premier plan, un pin sylvestre en lieu et place de l’arbre actuel.
La forêt de conifères qui surplombe le village sera également victime du changement climatique. La supprimer complètement relève de la provocation: d’autres espèces prendront le relais.
Cette vue très artificielle n’est pas une projection scientifique, mais elle permet de soulever plusieurs questions: à quoi ressembleront les forêts de demain? Quel sera l’impact de ces bouleversements sur les microclimats, la faune et la flore locale? Et pour les champignonneurs, trouvera-t-on encore des morilles aux pieds des pins sylvestres qui prendront possession de nos terroirs?
Rédaction Jura-24