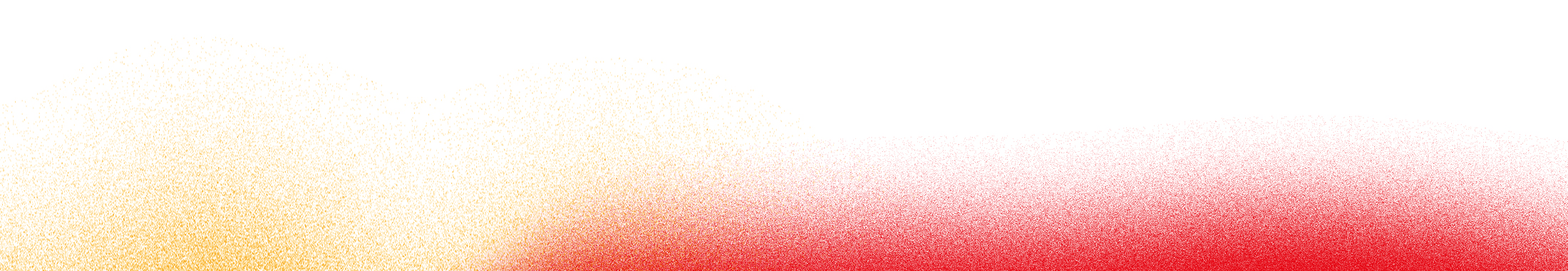Carte postale des Genevez
Passé
Verlag Erwin Bischoff, Wil
Les Genevez, 1919
Retirage d’une carte postale, 9 x 14 cm
MJ.2016.46.57
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Collection Xavier Jobin, Delémont
Présent
Julien Ogi
Sans titre, 2024
Photographie
Photo-club des Franches-Montagnes
Ferme traditionnelle
Élément essentiel du paysage des Franches-Montagnes, les fermes sont, comme lui, en constante mutation. Alors, « la » ferme traditionnelle franc-montagnarde existe-t-elle ?
Les fermes francs-montagnardes représentent des volumes plus bas que celles d’Ajoie ou de la vallée de Delémont. Les exemples les plus anciens conservés aujourd’hui datent des XVIe et XVIIe siècles. Très peu pentues, les toitures présentaient à l’origine, et c’est encore le cas pour une petite trentaine d’entre elles, quatre ou trois pans. C’est principalement dès le XVIIIe siècle que les nouvelles fermes se construisent sous un toit à deux pans ou que les plus anciennes « perdent » un pan ou deux, au gré des agrandissements. Ces toitures très peu pentues étaient couvertes de petites planches de bois appelées bardeaux. Ce n’est qu’au XXe siècle que les bardeaux sont remplacés par des tuiles à emboîtement, à l’exception de deux bâtiments : une ferme à deux pans à Muriaux et, bien entendu, le Musée rural jurassien aux Genevez.
Les façades principales se situent généralement au sud-ouest. Les façades nord-est sont les plus exposées et peuvent donc être recouvertes d’un revêtement de bois en forme de petites écailles appelées tavillons, de tuiles ou, plus récemment, d’amiante-ciment (Eternit). Les fermes sont souvent grandes et accueillent plusieurs familles. On parle alors de ferme double, voire de ferme triple.
Elles sont construites en pierre calcaire et crépies à la chaux. Parfois, le tiers supérieur du pignon arrière, voire du pignon avant, est couvert de planches de bois. On l’appelle la ramée. La grange haute est souvent accessible par un pont de grange, constitué par le terrain naturel ou aménagé artificiellement. Autour de la ferme, se trouvent traditionnellement une citerne pour récolter l’eau et la neige des toits, un jardin potager et un grenier de bois installé à l’origine face à la façade principale de la ferme, afin de pouvoir le surveiller.
Les fermes franc-montagnardes accueillent sous le même toit les espaces dévolus à l’agriculture (granges, étables, écuries, remises, parfois ateliers de transformation) et le logement des humains. C’est un vestibule, appelé devant-huis, qui sépare à l’intérieur les deux types d’espace. On y entre en général par une porte cochère, marquant fortement la façade. Certains espaces ont été transformés pour accueillir d’autres activités professionnelles exercées en plus du travail agricole : horlogerie, mécanique, artisanat, restauration. Le logement n’occupe quant à lui qu’une petite partie du volume, au maximum un tiers. On y trouve une cuisine voûtée dont le poêle communique avec la pièce d’à côté, appelée la belle chambre. Une autre chambre vient compléter l’aménagement intérieur. Parfois, une période particulièrement faste ou l’agrandissement de la famille ont poussé certains logements à s’étendre un peu dans la grange, avec l’ajout de chambres. Cette pratique a pris un fort essor ces dernières décennies où de nombreuses granges ont été transformées en logement. Enfin, la plupart des fermes possèdent également une cave voûtée. Dans les plus luxueuses, une grande table en pierre ancrée dans le sol conserve les aliments au frais aussi bien qu’un frigo.
Comme tous les bâtiments, les fermes franc-montagnardes ont donc connu de nombreuses transformations à travers les siècles, en raison de la famille qui s’agrandit, d’une situation économique qui s’améliore, des pratiques agricoles qui se modifient, de la vie professionnelle qui se diversifie, des goûts personnels, de la modification des modes de vie ou encore d’éléments extérieurs tels que des accidents ou des catastrophes.
Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques