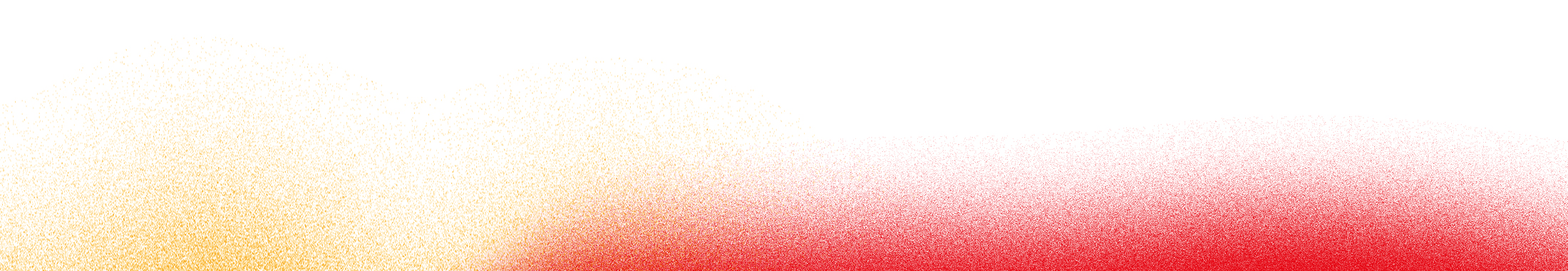Quitter le Noirmont
Vos premiers pas vous ont fait tourner le dos au Noirmont. Prenez un instant le temps d’observer le village, et notamment son extension.
En deux siècles, la population du Noirmont a presque doublé! Son développement économique débute au XIXe siècle avec l’apparition de fabriques de montres et le développement du chemin de fer. Un succès qui ne se dément pas! Plusieurs entreprises du Noirmont participe au volet delémontain de Jura-24 et à son exposition sur le Génie jurassien.
Mais Le Noirmont, c’est aussi une fromagerie qui produit la fameuse Tête de Moine!
Aux origines de la Tête de Moine
Appréciée des gourmets du monde entier, la Tête de moine a une très longue histoire, du Moyen Âge à nos jours. Au Noirmont se trouve justement l’une des fromageries capables de produire ce fromage caractéristique qui bénéficie d’une AOP.
Du fromage de Bellelay à la Tête de moine
Dès le 14e siècle, les chanoines de Bellelay produisent un fromage à pâte dure ou mi-dure. Il s’agit déjà d’un produit de qualité, qui doit être mûri au minimum de quatre à six mois. À cette époque, il peut être indifféremment au lait de vache ou de brebis. Au 15e siècle apparaît la dénomination « fromage de Bellelay » (en latin : caseus Bellelagiae). Il figure parmi les plus chers vendus alors au marché de Bâle. L’abbé en offre en cadeau aux puissants personnages dont il souhaite la faveur.
Jusqu’à la Révolution française, les chanoines produisent ce fromage sur leurs terres. En été 1778, Malesherbes, homme d’Etat et polygraphe français, décrit le travail des fromagers salariés par l’abbaye dans la vacherie de Béroie. Mais le couvent n’a pas le monopole de la production, et d’autres métairies de la région en fabriquent au 18e siècle. Cela explique que la Tête de moine ait survécu à la disparition de l’abbaye. Vers 1800, la Tête de moine a la même forme qu’aujourd’hui, mais est nettement plus grosse, puisqu’elle pèse environ 5-6 kg.
On raconte que le nom de Tête de moine a été inventé à la Révolution française, dans une intention satirique. Il n’en est rien, car il est déjà attesté en 1783 dans les comptes de la cuisine du prince-évêque de Bâle – peu suspect d’anticléricalisme…
Moinillon chapardeur et girolle
Depuis quand racle-t-on la Tête de moine ? La légende veut qu’un moinillon trop gourmand ait décalotté un fromage, raclé quelques « fleurs », puis remis la calotte afin de cacher son larcin. Surpris en flagrant délit, il est absous par l’abbé, enthousiasmé par les avantages gustatifs de cette nouvelle méthode ! En réalité, cette pratique est tardive, car les auteurs qui parlent du fromage de Bellelay jusqu’au début du 19e siècle ne précisent jamais qu’il faut le consommer en le raclant. Elle est probablement apparue dans le courant du siècle, favorisée par la réduction de la taille de la meule. L’invention de la girolle en 1982 facilite grandement la réalisation des « fleurs » et contribue de façon décisive à l’extraordinaire essor des ventes de la Tête de moine, en Suisse comme à l’étranger.
Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle
Pour déguster
De l'horlogerie
Paysage horloger
Défrichées tardivement, les Franches-Montagnes ont longtemps présenté un aspect austère, dû à une pauvreté endémique. Ce pays n’a pas été épargné par les guerres et les épidémies.
Aussi, après un XVIIe siècle calamiteux, l’apparition de l’industrie horlogère vers 1700 fut-elle accueillie avec soulagement par la population. Dès 1850, la morphologie de ses villages s’en trouve modifiée. Des immeubles locatifs, ainsi que des ateliers surgirent de terre.
Actuellement, en particulier au Bois, aux Breuleux, au Noirmont ainsi qu’à Saignelégier, des usines monumentales - et de réputation internationale - emploient une main d’œuvre hautement qualifiée, occupée notamment dans les secteurs de l’habillage horloger (boîtes et bracelets de montres), de la conception/réalisation/assemblage de mouvements d’horlogerie, et de la fabrication de produits dérivés (bijouterie, maroquinerie).
Boîtiers, horlogers, paysans…
Le « paysan-horloger » : réalité ou légende urbaine ? Servant de lien entre autarcie rurale et civilisation industrielle, le « paysan-horloger » appelle un éclairage historique nuancé. L’agriculture renvoie aujourd’hui aux professionnels de la culture et de l’élevage. Il n’en va pas de même du « paysan », qui se réfère à un monde oublié, peuplé de petits artisans (forgerons, tourneurs sur bois ou sur métal, meuniers, tisserands, teinturiers, dentelières) pour qui le « train de ferme » n’était pas un choix mais une nécessité alimentaire. Pas de grande distribution à l’époque ; on vivait uniquement de ce qui était produit ou fabriqué dans un rayon régional. Le XVIIIe siècle nous apportera l’horlogerie, qui mettra tout de même plus de 150 ans pour supplanter les usages ancestraux. Cette même horlogerie attirera dès après 1880 les premiers magasins, qui étoufferont toute velléité d’autarcie. Elle introduira une certaine aisance pécuniaire, créant ainsi un besoin de confort et de vie associative (chorales, fanfares, sociétés sportives).
Métropole boîtière
Au milieu du XIXe siècle, sous l’influence conjuguée du chemin de fer (= ponctualité) et de la télégraphie (= heure unifiée), la montre devient indispensable. Pour satisfaire à la demande, beaucoup d’entreprises se créent. Après 1890, la force et la lumière électrique apportent sécurité et efficacité dans les usines, multipliant la production par dix. A l’aube du XXe siècle, on dénombre plus de monteurs de boîtes or, argent ou métal au Noirmont (1900 habitants à l’époque) qu’à La Chaux-de-Fonds, qui compte alors 23'000 habitants. L’un des treize Bureaux fédéraux de contrôle des métaux précieux est ouvert au Noirmont en janvier 1884 ; il est toujours en activité.
Georges Cattin, Musée de la boîte de Montre, Le Noirmont
Pour aller plus loin
Le Noirmont abrite depuis 2015 le « Musée de la Boîte de Montre ». Longtemps négligé, le patrimoine boîtier de la région s’est ainsi offert le premier – et le seul – musée au monde consacré à l’habillage horloger. En le visitant, vous découvrirez les singularités technologiques et esthétiques de cette profession, située à la jonction de l’art et de la haute précision.
Vue sur le Noirmont
D’ici, on a une vue exceptionnelle sur Le Noirmont et son extraordinaire expansion. Le village s’est fortement densifié et étendu en presque un siècle, comme en témoigne l’image ci-dessous. On reconnaît tout de même quelques bâtiments emblématiques. Surplombant le village, le bâtiment principal de la clinique domine la localité. L’imposant bâtiment a été construit entre 1905 et 1907. Ancien pensionnat, il accueille depuis 1985 les patients du Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire. Vous devriez même apercevoir le bâtiment annexe en béton construit en 1985 en contrebas du bâtiment principal.
Noyée dans le village, l'ancienne église du Noirmont a été construite en 1670 sur une chapelle consacrée en 1513. De cette première église subsistent la tour, le chœur et une partie du mobilier religieux, notamment la magnifique chaire. À sa construction, selon un dessin de l’abbé Joseph Godat, l’église Saint-Hubert présente une toiture en pierres (appelées « laves » dans notre région)[1]. Aujourd’hui, l’église de Soubey est considérée comme le seul exemple de bâtiment doté d’une telle toiture en Suisse, au nord des Alpes.
Après avoir été désaffectée en 1969. En 1988, pour la sauver de la démolition, la Fondation Sur-la-Velle l'acquiert et mène des rénovations importantes entre 1991 et 2017. Ces dernières ont préservé des éléments historiques, tout en modernisant l'intérieur pour en faire un lieu polyvalent adapté aux activités culturelles. Aujourd'hui, l'église, rebaptisée Espace La Velle, est un centre culturel.
Jusqu’au 28 septembre, Jura-24 y présente une exposition intitulée “Franches-Montagnes. Le paysage en mouvement”.
Élodie Paupe, responsable du site Jura-24 des Franches-Montagnes
Édition John Dubois, La Chaux-de-Fonds Le Noirmont, 1900-1944 Retirage d’une carte postale, 8.8 x 13.8 cm Inv. 1989.1513 Musée de l’Hôtel-Dieu, Fonds Gustave Amweg, Porrentruy