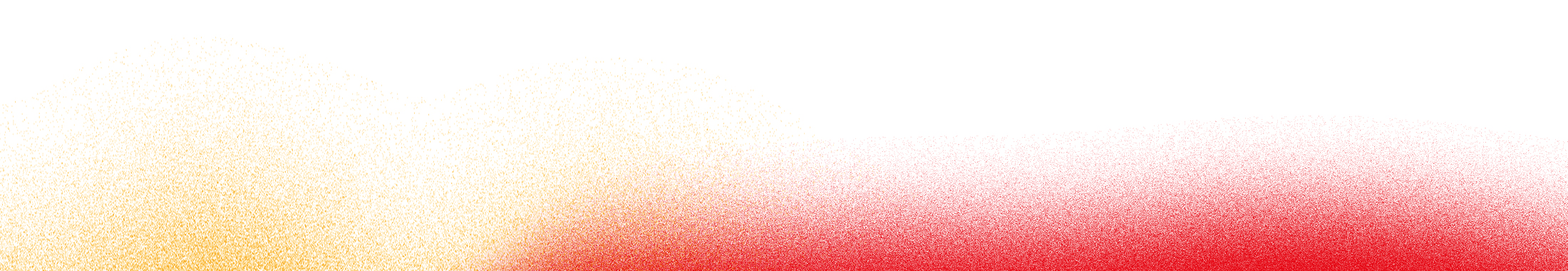Au cœur des pâturages
La balade se poursuit entre pâturage boisé, bétail et dolines. Vous ne les avez pas vues?
Discrètes et de petite taille à proximité du chemin, elles sont bien plus impressionnantes en contrebas, là où se trouve la forêt. N’hésitez pas à vous écarter un peu du sentier pour observer ce relief particulier ! On retrouve également de nombreuses dolines sur la balade qui relie Le Noirmont aux Breuleux.
La balade se poursuit en direction de l’Étang des Royes et de ses intrigantes sphaignes.
Dolines et emposieux
Le plateau franc-montagnard est dépourvu de cours d'eau en surface. Les abondantes précipitations typiques du climat jurassien sont bien collectées dans un réseau hydrographique, mais leur circulation se fait de manière souterraine. Cette particularité s'explique par la nature du sous-sol: la roche mère, le calcaire, peut se dissoudre lentement sous l’action de l’eau et la laisser s’infiltrer.
L'eau circule en profondeur en utilisant et en agrandissant les fissures du calcaire, notamment par une altération chimique provoquant la dissolution de la roche. Le produit de cette forme d'érosion hydrogéologique se nomme le karst. Il aboutit à la formation de particularités géologiques et paysagères typiques de la région: dolines, grottes, lapiés, etc.
Les dolines (appelées aussi emposieux) sont des dépressions plus ou moins circulaires du sol karstique. Elles mesurent généralement quelques mètres de diamètre et de profondeur, mais peuvent faire jusqu’à 50-70 mètres de diamètre ! Il existe plusieurs processus de création des dolines. La doline peut se créer par exemple lorsqu'une galerie souterraine dissoute par l'eau acidifiée est proche de la surface. Les couches calcaires au-dessus de cette galerie s'effondrent et forment une dépression. On parle de doline d’effondrement.
L'alternance marne / calcaire du relief jurassien a donné naissance à des paysages et des végétations très différentes. Les calcaires durs sont perméables à l'eau et vont être en général à l'origine d'une végétation xérophile (végétation adaptée aux milieux secs). Les marnes, au contraire, contiennent des argiles qui sont imperméables et empêchent l'eau de s'écouler. En présence d'une cuvette marneuse qui retient l'humidité du sol, on trouvera ainsi des plantes qui sont adaptées aux zones plus humides. Ces milieux très différents peuvent se succéder sur de très petites surfaces.
Texte tiré de la brochure L’essentiel sur les pâturages boisés, réalisée par le Parc Naturel Régional du Doubs, 4e édition en 2020. Pour la commander, rendez-vous sur le site Internet du Parc.
Pour aller plus loin
Brochure de l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie
L'élevage, une spécialité franc-montagnarde
Les agriculteurs taignons sont avant tout des éleveurs. Ceci s’explique assez facilement par le climat rude qui a longtemps régné dans nos contrées et également par la topographie pas toujours facile. Si on ajoute à cela la faible profondeur utile des sols, il devient évident que les cultures vivrières ne se plaisent guère dans les Franches. La production herbagère et, par conséquent, l’élevage d’herbivores sont les productions les plus adaptées à notre région. Les « taignons » sont des éleveurs et pas des moindres, car leurs compétences sont reconnues loin à la ronde autant dans le milieu des vaches laitières que dans celui du cheval de race Franches-Montagnes.
La production bovine est prépondérante dans la région, avec environ 15'000 têtes de bétail en 2020. Cependant, alors qu’il était presque exclusivement dédié à la production laitière jusque dans les années 1990, l’élevage bovin s’est progressivement diversifié avec l’abandon prévisible des contingents laitiers, qui a été effectif en 2002. Depuis 2010, les vaches allaitantes représentent environ 60% de toutes les vaches. Autrefois détenus à l’attache, les bovins sont désormais majoritairement en stabulation libre. En 1990, on dénombrait environ 16'100 têtes de bétail bovin ; une diminution de 7% s’est opérée jusqu’en 2020.
L’élevage du cheval Franches-Montagnes reste une branche importante et emblématique de la région. Le cheptel est passé de 1350 chevaux en 1990 à 2050 chevaux en 2010 pour redescendre à 1520 chevaux en 2022. Il est difficile de savoir quel part de ces chevaux est destinée à l’élevage et quelle part est constituée des chevaux de loisirs en pension. Cette dernière activité est plus rentable, mais elle n’apporte pas les mêmes satisfactions que l’élevage et la sélection du cheval Franches-Montagnes. N’est-ce pas une fierté que de voir un de ses sujets retenu au rappel du Marché-Concours ? Tout comme les bovins, les chevaux étaient autrefois détenus à l’attache dans les fermes. Depuis le début des années 2000, il est obligatoire de détenir les chevaux en boxe ou en stabulation libre. De nombreux investissements ont été réalisés pour satisfaire ces nouvelles exigences.
Julien Berberat, Fondation Rurale Interjurassienne
Évolution des cheptels de 1990 à 2022. Chèvres, équidés, moutons et porcs sur l’échelle de gauche. Bovins et volailles sur l’échelle de droite.
Les sphaignes, bâtisseurs de tourbières
Les sphaignes sont les mousses des tourbières et leurs magnifiques couleurs illuminent ces petits paysages d’aspect nordique. Passées maîtres dans l’art de créer leur environnement, elles garantissent leur survie en stockant l’eau, en acidifiant le milieu et en l’appauvrissant en matières nutritives, ce qui le rend hostile aux autres espèces. Mortes, les sphaignes continuent de stocker l’eau et les éléments nutritifs tout en se transformant en tourbe. Seules les parties basales meurent, alors que les parties apicales continuent de croître indéfiniment. L’acidité du milieu empêche la croissance des bactéries et des champignons, qui jouent habituellement le rôle de décomposeurs de la matière végétale. Cette acidité, jointe au manque d’oxygène dû à la saturation en eau, ralentit fortement la décomposition des sphaignes. Lorsque leur taux de croissance est plus fort que leur taux de décomposition, la tourbe s’accumule. Cette accumulation est très lente, de l’ordre de 0,3 à 1 mm par an à la tourbière de la Gruère selon les sondages. Une épaisseur de tourbe de 7,92 mètres y a été mesurée, ce qui donne un âge de près de 10’000 ans à cette extraordinaire tourbière.
Il existe une trentaine d’espèces de sphaignes en Suisse, qui se répartissent au sein des écosystèmes selon trois gradients : humidité, teneur en substances nutritives et lumière.
Grâce à leur capacité de stockage de l’eau, certaines espèces pouvant stocker jusqu’à 30 fois leur poids en eau, les tourbières sont de véritables éponges. Aux Franches-Montagnes, ce plateau sans rivières, elles furent utilisées dès le 17ème siècle pour leur potentiel hydrique. Par un système de drainage, les eaux étaient collectées dans l’étang situé en contrebas, puis dirigées vers la scierie ou le moulin, où elles jouaient leur rôle de force motrice, avant de se perdre dans une doline. La dernière scierie à fonctionner de cette manière, celle de la Gruère, a été électrifiée dans les années 50. Des étangs, avec les vestiges de construction qui leur étaient associés, s’observent encore aujourd’hui aux Royes, à la Chaux-des-Breuleux, à Plain de Saigne et à la Chaux d’Abel.
Archives vivantes et puits de carbone
Les tourbières, du fait de l’acidité et du manque d’oxygène de la tourbe, conservent la matière organique sans la dégrader et constituent de ce fait des archives vivantes.
Au niveau mondial, les tourbières stockent 3 fois plus de carbone que toute la biomasse terrestre.
Elizabeth Feldmeyer-Christe, Dr ès sciences, biologiste
Sphagnum angustifolium © Elizabeth Feldmeyer-Christe
Tourbière de la Chaux-des-Breuleux © Elizabeth Feldmeyer-Christe
Étang de la Gruère © RCJU
Robert Kiener, Etang des Royes, 1939, huile sur carton, 31.5 x 40.5 cm, MJ.2021.110.1, Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont.