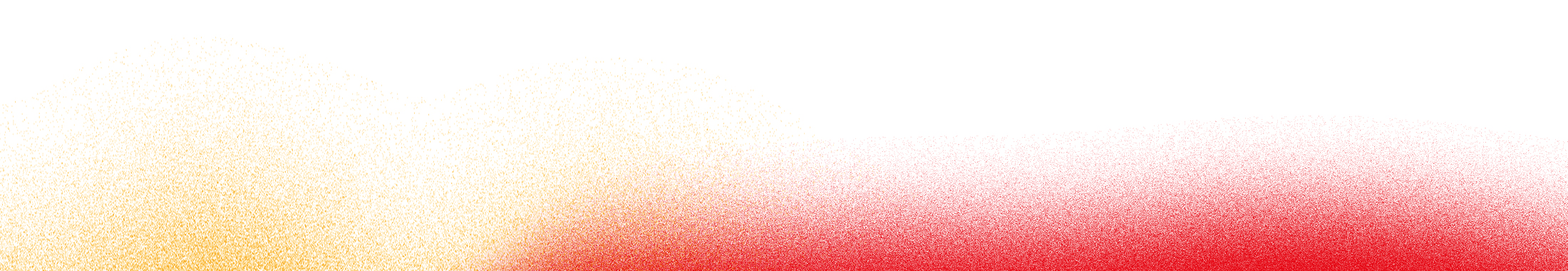Portrait d’Imier de Ramstein
Peintre anonyme
Portrait d'Imier de Ramstein (? - 1395), (après 1782)
Huile sur carton
33 x 27 cm
Inv. 1053
Collection jurassienne des beaux-arts, Porrentruy
Imier de Ramstein. Le prince-évêque aux trois sapins
Les trois sapins représentés sur le portait d’Imier de Ramstein sont-ils les prémices d’une iconographie des paysages francs-montagnards ?
Peintre anonyme, Portrait d’Imier de Ramstein (?-1395), (après 1782)
Huile sur carton, 33 x 27 cm
Collection jurassienne des beaux-arts
Ce portrait d’Imier de Ramstein fait partie d’une série de 75 portraits d’évêques de Bâle conservés dans la Collection jurassienne des beaux-arts. À la fin du 14e siècle, Imier de Ramstein a joué un rôle majeur dans le développement des Franches-Montagnes. Afin de favoriser le peuplement de ce plateau situé à une altitude moyenne de 1000 mètres, il accorde des privilèges fiscaux à tous ses habitants, d'où le nom de Franches-Montagnes. En effet, dans une charte de franchise rédigée en latin et datée du 17 novembre 1384, il modère le tarif des taxes désormais exigibles sur la totalité du territoire du haut-plateau dont il esquisse les limites géographiques.
Ce brave homme est donc intimement lié à l’indépendance et à la prospérité de la région. Ainsi, lorsque son portrait fut réalisé, probablement à la fin du 18e siècle, le peintre resté anonyme lui attribua trois petits sapins afin de souligner l’influence positive de sa charte sur le destin des Franches-Montagnes.
Sur les 75 portraits de forme ovale et de facture modeste que contient cette série, il s’agit du seul tableau qui dispose d’un arrière-plan de paysage. Imier est peint de profil, vêtu d’une soutane ocre rouge et d’un col à rabat blanc. Son visage fin est surmonté d’une perruque poudrée totalement anachronique (comme son costume du reste). Il ne porte ni la mitre, ni le bonnet d’évêque quadrangulaire, ni la calotte, contrairement à la plupart des autres prélats, et arbore comme seul attribut épiscopal une croix pectorale. À sa droite, le petit paysage aux trois sapins est un joli clin d’œil du peintre.
Cette œuvre nous apporte la preuve qu’à la fin du 18e siècle, le sapin était déjà attribué à la région du haut-plateau comme signe distinctif. Selon l’historien et héraldiste Nicolas Vernot, le sapin apparaît déjà dans les sceaux et armoiries des Franches-Montagnes dès le 17e siècle. Il en a disparu vers le milieu du 18e siècle. Dans son « Armorial du Jura » (2022), il relève (p. 42) que certaines familles originaires des Franches-Montagnes ont adopté dans leurs armoiries un sapin dès le 16e siècle, probablement pour évoquer leurs origines.
Nous ignorons encore d’où provient cette galerie de portraits qui s’ouvre avec Saint Pantale (mort martyr vers 451) et se termine avec Frédéric de Wangen de Géroldseck (1727-1782). Il se peut qu’elle provienne du château ou d’un lieu de culte de Porrentruy, peut-être de l’ancienne église des Jésuites qui était également l’église de la cour épiscopale jusqu’à l’annexion de l’Évêché de Bâle à la France (1793-1815). Ces portraits auraient-ils échappés aux spoliations ? Aucune certitude ! Nous pouvons toutefois affirmer qu’ils ont été conservés par Louis Vautrey et légués à la Bibliothèque de l’École cantonale de Porrentruy, lors de son décès en 1886. Son testament en témoigne sans donner davantage de précisions.
Testament de Louis Vautrey, 2e feuillet. ArCJ 21 J 3.
Aline Rais Hugi, responsable de la Collection jurassienne des beaux-arts
Pour aller plus loin
Découvrir les autres pièces du leg
Romain Jurot, "Ramstein, Imier de", dans Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 02.08.2010. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012889/2010-08-02/.
Naissance des Franches-Montagnes
À quand remonte l’occupation humaine du haut-plateau ? Voilà une question qu’il n’est pas facile de trancher… La fameuse dent d’un homme de Neandertal retrouvée dans les grottes de Saint-Brais a été datée de 40’000-35'000 avant Jésus-Christ. Ces abris ont été régulièrement visités jusqu’à 1450-1200 av. J.-C., mais peut-on parler de présence durable ? Durant l’Antiquité, la voie transjurane qui passe par Pierre-Pertuis traverse l’extrémité du plateau franc-montagnard, mais des individus s’étaient-ils établis sur ces hauteurs ? Les traces archéologiques sont peu nombreuses et ne permettent pas de l’affirmer.
De quand datent les plus anciennes mentions de localités dans les Franches-Montagnes ? Il faut attendre le XIIe siècle et une bulle du pape Innocent II (14 avril 1139). Dans cet acte, le pape confirme les biens du chapitre canonial de Saint-Ursanne parmi lesquels figurent Planey, un village situé à l’est de l’actuel Saint-Brais, probablement détruit au XVIIe siècle, et Montfaucon. La paroisse de Montfaucon couvre longtemps toutes les Franches-Montagnes, ce qui explique que celles-ci portent le nom de « Montagne du Faucon » dans les textes les plus anciens.
Conon de Pleujouse est le premier seigneur du haut-plateau, qu’il tient sans doute en fief de l’évêque de Bâle. Il fait bâtir le château de Muriaux ou du Spiegelberg, dont il prend le nom dès 1315. La famille des nobles de Muriaux possède des armoiries bien connues puisqu’elles sont aujourd’hui encore celles du district des Franches-Montagnes. Au XIVe siècle, la dénomination « Montagne de Muriaux » apparaît – ou Spiegelberg dans les textes en allemand.
Une date revient toujours lorsqu’on retrace l’histoire des Franches-Montagnes : 1384. Cette année-là, le prince-évêque, Imier de Ramstein donne une charte de franchise au pays. Cette dernière pose pour la première fois les limites du territoire des Franches-Montagnes qui s’étend de Montfaucon aux Esserts d’Îles (Biaufond) et de Tramelan au Doubs. La charte limite les redevances annuelles que les habitants devront payer pour leurs terres ou maisons d’habitation ; surtout, privilège rare dans les campagnes, elle les exempte de la taille – une taxe seigneuriale arbitraire détestée des paysans. Grâce à la charte, la seigneurie gagne un nouveau nom très flatteur : « la Franche Montagne » ! Il finira par s’imposer. Le pluriel « les Franches-Montagnes » n’apparaît qu’au XIXe siècle.
Élodie Paupe, responsable du site des Franches-Montagnes
Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle
Pour aller plus loin
Jean-Paul Prongué, La Franche Montagne de Muriaux à la fin du Moyen Âge, Porrentruy : Société jurassienne d'émulation, 2000.