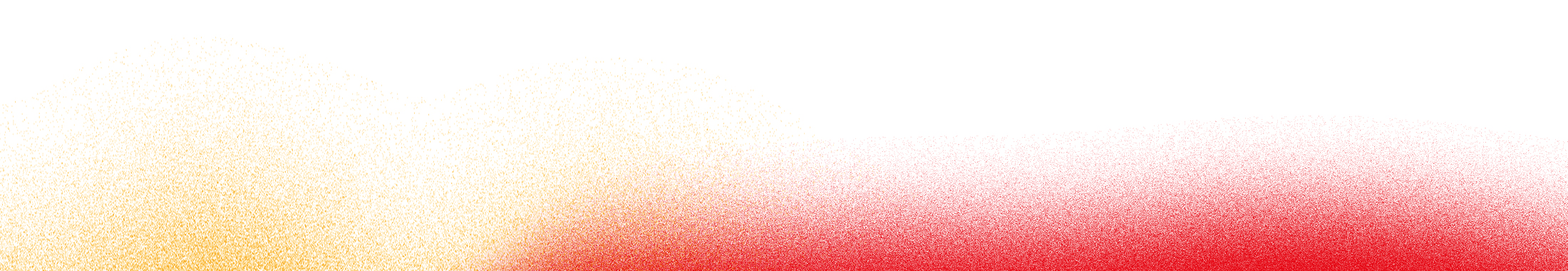Garance Finger et la métonymie du paysage
Garance Finger
Gargan et Pan, 2020
Blocs de sel sculptés, 18 x 18 x 18 cm (pièce)
Collection de l’artiste
Garance Finger et la métonymie du paysage
Garance Finger (*1981) est née à Delémont et vit à Porrentruy. Dès 2001, elle suit une formation en cinéma à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), puis se perfectionne en arts visuels. Gardant la vidéo au cœur de son travail, elle étend sa pratique artistique à différents moyens d’expression et réalise des installations. Elle reçoit le Prix François Lachat pour « Gargan et Pan », lors de la 18e Biennale de visarte.jura (Courfaivre, 2020).
« Jura, intime », tel fut le thème de cette Biennale particulière, en pleine épidémie de Covid-19, et pourtant inspirante aux yeux de Garance Finger. Pour elle « un sourire, c’est quelque chose d’intime ». Dans « Gargan et Pan », les 28 blocs de sel (32 présentés à Courfaivre) sont disposés en cercle à l’instar d’une dentition gigantesque à laquelle on aurait retiré les quatre dents de sagesse. Effectivement, on peut y voir l’évocation d’une intimité dévoilée, tel un immense dentier présenté dans un espace d’exposition.
Mais s’agit-il bien, comme le suggère le titre, de dents de géants à la mesure de celles de Gargantua et de Pantagruel ? Garance Finger convoque aussi Pan, le dieu gardien des troupeaux qu’il ne faut surtout pas réveiller de ses siestes au risque de se confronter à un dur châtiment, celui de la peur panique.
En tous les cas, l’installation de Garance Finger suscite l’interrogation. En y regardant de près, le public averti découvre qu’elle se compose de blocs de sel et plus précisément de pierres à lécher à disposition du bétail que l’on trouve dans les pâturages.
On peut dès lors voir naître un paysage en partant d’un élément qui le compose. Sel, puis bovins et caprins, fermes et sapins…
Métaphore du temps qui passe ou de l’impermanence des choses, les blocs de sel de Garance Finger sont autant de paysages miniatures et portatifs qui évoquent les glaciers et l’érosion de la matière. Et pourtant, l’artiste le sait bien, le sel comme les dents résistent au temps.
Avec détermination et humour, Garance Finger réalise un travail d’équipe entre les agriculteurs, prêts à participer à l’expérience, les animaux (vaches et chèvres et leurs coups de langue remplaçant la gouge !) et elle-même, seule juge à définir l’état achevé d’une pièce. La plasticienne se laisse d’ailleurs surprendre par le résultat en déléguant le processus de création à des tiers. Elle réfute de ce fait la notion de ready-made, car il y a bien eu intervention sur des objets choisis, peut-être, en premier lieu, pour leur valeur sculpturale évidente ou par leur aspect matériel qui rappelle le marbre. Au départ, ils ne sont que des éléments discrets d’un paysage de campagne que l’artiste décide de mettre en lumière.
Garance Finger a filmé à plusieurs reprises ses performances artistiques dans lesquelles elle se met en scène. Dans « Gargan et Pan », rien de tout cela. Et pourtant, l’œuvre en devenir (que l’on imagine encore dans les pâturages, léchée par le bétail) acquiert une importance essentielle pour le spectateur. Intuitivement, il recrée le déroulement de l’histoire, comme s’il s’agissait d’un film. La dramaturge lui laisse le choix des images… c’est très fort !
Aline Rais Hugi, responsable de la Collection jurassienne des beaux-arts
L’élevage, spécialité franc-montagnarde
Les agriculteurs taignons sont avant tout des éleveurs. Ceci s’explique assez facilement par le climat rude qui a longtemps régné dans nos contrées et également par la topographie pas toujours facile. Si on ajoute à cela la faible profondeur utile des sols, il devient évident que les cultures vivrières ne se plaisent guère dans les Franches. La production herbagère et, par conséquent, l’élevage d’herbivores sont les productions les plus adaptées à notre région. Les « taignons » sont des éleveurs et pas des moindres, car leurs compétences sont reconnues loin à la ronde autant dans le milieu des vaches laitières que dans celui du cheval de race Franches-Montagnes.
La production bovine est prépondérante dans la région, avec environ 15'000 têtes de bétail en 2020. Cependant, alors qu’il était presque exclusivement dédié à la production laitière jusque dans les années 1990, l’élevage bovin s’est progressivement diversifié avec l’abandon prévisible des contingents laitiers, qui a été effectif en 2002. Depuis 2010, les vaches allaitantes représentent environ 60% de toutes les vaches. Autrefois détenus à l’attache, les bovins sont désormais majoritairement en stabulation libre. En 1990, on dénombrait environ 16'100 têtes de bétail bovin ; une diminution de 7% s’est opérée jusqu’en 2020.
L’élevage du cheval Franches-Montagnes reste une branche importante et emblématique de la région. Le cheptel est passé de 1350 chevaux en 1990 à 2050 chevaux en 2010, pour redescendre à 1520 chevaux en 2022. Il est difficile de savoir quelle part de ces chevaux est destinée à l’élevage et quelle part est constituée des chevaux de loisirs en pension. Cette dernière activité est plus rentable, mais elle n’apporte pas les mêmes satisfactions que l’élevage et la sélection du cheval Franches-Montagnes. N’est-ce pas une fierté que de voir un de ses sujets retenu au rappel du Marché-Concours ? Tout comme les bovins, les chevaux étaient autrefois détenus à l’attache dans les fermes. Depuis le début des années 2000, il est obligatoire de détenir les chevaux en boxe ou en stabulation libre. De nombreux investissements ont été réalisés pour satisfaire à ces nouvelles exigences.
Julien Berberat, Fondation Rurale Interjurassienne
Évolution des cheptels de 1990 à 2022. Chèvres, équidés, moutons et porcs sur l’échelle de gauche. Bovins et volailles sur l’échelle de droite.