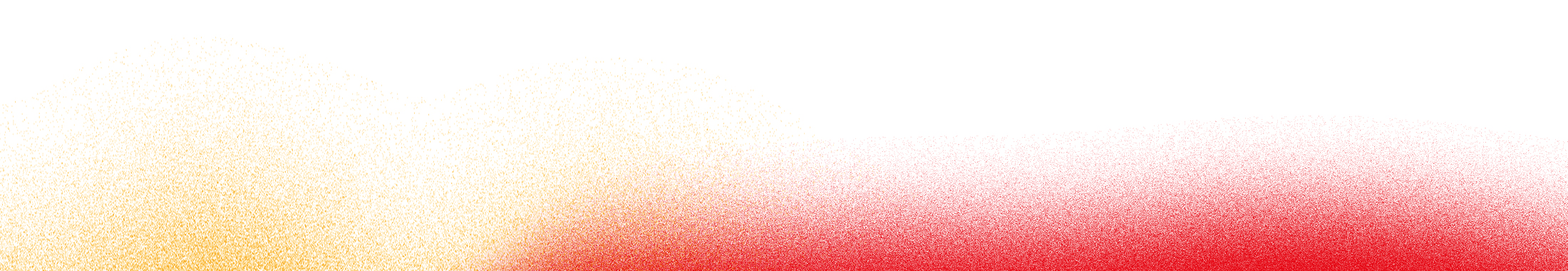Carte postale de Soubey
Passé
H. Le Roy, phot.-édit.
Soubey, 1918
Retirage d’une carte postale, 9 x 14 cm
MJ.2016.46.1524
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Collection Xavier Jobin, Delémont
Présent
Julien Ogi
Sans titre, 2024
Photographie
Photo-club des Franches-Montagnes
L’église Saint-Valbert et sa couverture en laves
Construite entre 1632 et 1670, l’église de Soubey a notamment été rénovée par Jeanne Bueche en 1961/62. La toiture en dalles de pierre (appelées « laves » dans notre région) a été refaite en 1981/2. C’est aujourd’hui le seul bâtiment du canton dont la toiture principale est encore pourvue d’une telle couverture. Il est même considéré comme le seul exemple de Suisse situé au nord des Alpes. Il s’agissait pourtant, jusqu’au XXe siècle, d’un type de couverture bien présent dans les Franches-Montagnes. L’église de Saignelégier, démolie en 1927, en était couverte et c’était aussi très certainement le cas pour celle de Saint-Brais, dont la toiture du clocher était encore en pierre jusqu’à sa démolition en 1921. À sa construction en 1670, l’ancienne église Saint-Hubert du Noirmont dans laquelle se tient l’exposition présente une toiture en pierres, selon un dessin de l’abbé Joseph Godat [1].
Situées en Franche-Comté, aujourd’hui de l’autre côté de la frontière nationale, mais dans la même aire culturelle et constructive que les Franches-Montagnes, les églises de Fessevillers sur le plateau de Maîche, du Bizot, des Bréseux et de Fleurey ainsi que celle de Chaux-les-Châtillon sont toutes encore pourvues d’une couverture en laves. C’est également le cas un peu plus loin, dans le Jura français, près de Lons-le-Saunier, de celle de Mirebel, de Bonnefontaine et de La Marre. Les toitures en pierres sont très répandues en Bourgogne et en Franche-Comté, dans l’architecture civile, rurale et religieuse.
Si l’on revient en Suisse, on connaît à Saint-Imier la tour de la reine Berthe, vestige de l’ancienne église, qui est pourvue d’une couverture en laves. On peut également encore voir des couvertures de fours en pierres dans le Jura, notamment à Saint-Brais. La couverture en pierres était jugée plus sécurisée en cas d’activité liée au feu (four ou forge).
Ces informations nous indiquent donc que les laves constituaient un type de couverture bien présent dans l’architecture religieuse des Franches-Montagnes. Traditionnellement, on construit avec ce que l’on trouve autour de nous. Ce sont les chemins de fer puis les camions qui, plus tard, permettent d’importer à grande échelle des matériaux différents. Nos crépis sont faits de chaux, fabriquée à partir du calcaire, alors que les bardeaux des toits et les ramées des façades sont issus des résineux des forêts environnantes. Il paraît donc tout à fait pertinent d’imaginer des couvertures en laves plus fréquentes qu’aujourd’hui, la pierre constituant un matériau local présent naturellement. De nombreux lieux-dits sont encore appelés « laviers », « lavières », « clos aux laves » ou aux « laives », c’est dans ces petites carrières que l’on prélevait les laves pour les toits, mais aussi pour les revêtements de sol des cuisines.
Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques
[1] STOCKER Pascale, « La vieille église du Noirmont : histoire et actualité » in : L’Hôta, n°12, 1988, p. 53.