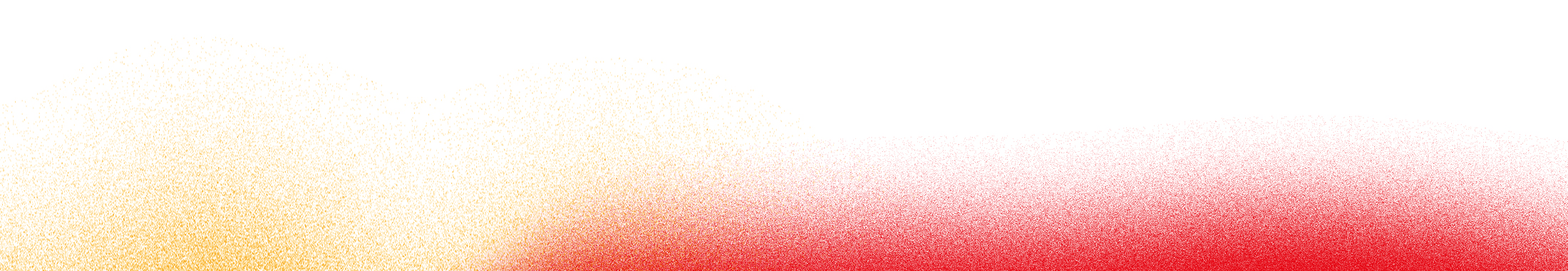Carte postale de La Chaux-des-Breuleux
Passé
R. Kohly
La Chaux-des-Breuleux, ferme Frésard, le cyclone du 12 juin 1926
Retirage d’une carte postale, 9 x 14 cm
MJ.2016.46.1557
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Collection Xavier Jobin, Delémont
Présent
Julien Ogi
Sans titre, 2024
Photographie
Photo-club des Franches-Montagnes
Les avant-toits des fermes
En 1926, une catastrophe frappe la région : une tornade. Le toit de la ferme Frésard, à La Chaux-des-Breuleux, est arraché. À sa reconstruction, la toiture est radicalement transformée : on lui ajoute des avant-toits de grandes dimensions, dans un style qui n’est pas traditionnel dans les Franches-Montagnes. Qu’a-t-il bien pu se passer ?
Dans les Franches-Montagnes, les fermes possèdent bien entendu des avant-toits en bois protégeant les façades, mais ceux-ci ne débordent généralement pas de plus d’une trentaine de centimètres, « afin d’éviter que le vent ne s’engouffre sous la couverture ou que le poids de la neige ne brise ce porte-à-faux. »[1] .) Par ailleurs, en façade pignon, les avant-toits sont en règle générale encore plus réduits qu’en façade gouttereau. Les fermes étant généralement correctement orientées, la façade pignon est celle qui est la moins exposée à la pluie, elle n’a donc pas besoin de la protection de longs avant-toits.[2] ()
Certes, il se peut qu’on ajoute à la façade pignon de certaines fermes un rang-pendu, c’est-à-dire une petite galerie en bois construite en encorbellement, mais principalement au début du XXe siècle, on voit apparaître des éléments de dimensions plus importantes. Il s’agit de berceaux lambrissés, pouvant rappeler les Ründi bernois ou les fermes de Gruyère.[3]Ces éléments architecturaux n’appartenant pas à la tradition constructive du Jura, on peut se questionner sur les raisons de leur apparition. Une explication est peut-être à chercher du côté de la mode architecturale de l’époque. Le tournant du XXe siècle est un période où l’architecture vernaculaire se diversifie. On cherche de nouveaux langages en allant chercher dans le passé (c’est le style historicisant) ou on pioche dans d’autres traditions architecturales suisses, généralement rurales : c’est le Heimatstil. Parfois, comme le rappelle Isabelle Roland, c’est simplement l’origine bernoise du charpentier, de l’architecte ou des occupants de la ferme qui mène à cette importation de style
Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques
[1] ROLAND Isabelle, Les maisons rurales du canton du Jura, 2012, p. 301.
[2] BABEY Marcellin, « Comment on germanisa le Jura : l’exemple des avant-toits » in : L’Hôta, n°15, 1991, p. 15.
[3] ROLAND Isabelle, Les maisons rurales du canton du Jura, 2012, p. 304.
Quels seront les impacts des changements climatiques sur les forêts jurassiennes ?
Avez-vous noté le changement d’espace dans le photomontage?
Les changements climatiques impactent déjà abondamment les forêts jurassiennes, avec des effets positifs comme négatifs. A l’avenir, les incendies forestiers seront plus fréquents, tous comme probablement les dégâts dus aux ravageurs, conséquence de la hausse des températures de l’air et de l’augmentation du nombre et de l’intensité de périodes caniculaires. Les dégâts dus aux chaleurs excessives et à la sécheresse impactent les jeunes arbres avant tout. Les forêts devraient tendre à être moins denses et donc à stocker moins de CO2 qu’actuellement. En outre la qualité des bois indigènes devrait globalement diminuer et donc poser des problèmes pour la sylviculture.
Les tempêtes, plus généralement tous les types de phénomènes météorologiques extrêmes, seront également plus fréquents et plus intenses. Les événements tels qu’éboulement et chutes de pierre devraient également tendre à augmenter en conséquence. Les risques de gel printaniers tendent aussi à augmenter en montagne (>800m.).
Il existe toutefois des aspects positifs en conséquence à la hausse des températures de l’air. Les dommages causés par la pression de la neige vont continuer de diminuer avec la raréfaction des précipitations sous forme neigeuse, et la période de végétation continuera de s’allonger progressivement à l’avenir.
L’ampleur des problèmes susmentionnés dépendra évidemment des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, plus ceux-ci seront élevés, plus les changements climatiques seront problématiques pour la biodiversité.
Il y a des espèces gagnantes pour lesquels les changements climatiques sont bénéfiques, comme globalement les espèces de chênes et aulnes. Des espèces sont quant à elles perdantes, petit à petit plus adaptées au climat qui se réchauffe. C’est le cas du hêtre (Fagus sylvatica) et de l’épicéa (Picea abies. Leur aire de répartition se limitera probablement aux crêtes du Jura d’ici la fin du siècle. En effet, ces deux espèces souffrent particulièrement de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de sècheresses estivales, accompagnées de températures très élevées qui assèchent rapidement les sols et les arbres. Les hêtres ont alors tendance à sécher et mourir, alors que les épicéas sont ravagés par le bostryche durant les canicules estivales.
Ces espèces verront donc leurs aires de répartition décliner progressivement au profit d’autres espèces.
L’institut fédéral de recherches sur la neige, la forêt et le paysage (WSL) a mis au point une plateforme qui permet de voir quels sont les aires possibles de répartition des principales espèces d’arbres forestiers à l’avenir en Suisse.
L’équipe du professeur Zimmermann (WSL) a auparavant effectué des travaux semblables sur différentes espèces et périodes, ci-dessous l’exemple pour l’épicéa :
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL
Valentin Comte, climatologue, CEDD-Agro-Eco-Clim