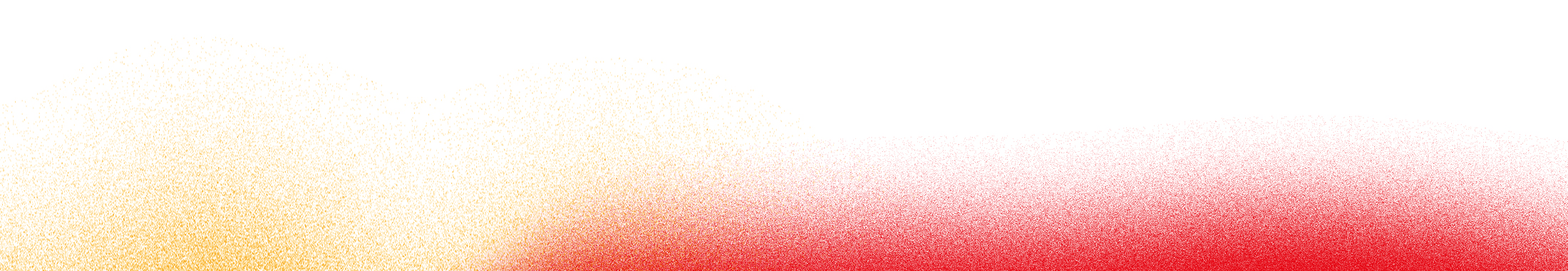Quitter Les Genevez
Vous venez de quitter l’une des deux localités que vous traverserez lors de cette balade.
En sortant du village, vous êtes passé devant le Musée rural des Genevez, un musée reconnu comme étant d’importance cantonale. Pourquoi ne pas le visiter lors d’une prochaine visite?
Ensuite, vous avez traversé un pâturage boisé typique des Franches-Montagnes. Vous traversez maintenant des cultures avant de vous enfoncer dans la forêt: c’est toutes la variété des paysages franc-montagnards qui s’offrent à vous sur ces quelques kilomètres.
Attention d’ailleurs à bien suivre le balisage Jura-24: lorsque vous arrivez à la forêt, empruntez bien le sentier qui la longe et ne suivez pas la route.
Toponymie
Il ne vous aura pas échapper que les noms des localités des Franches-Montagnes diffèrent beaucoup du reste du territoire cantonal. Aucun village en « court » sur le haut-plateau, mais toute une série de noms précédés de déterminants. Curieux hasard, vous dites-vous ? Il n’en est rien. Mais pour décrypter les secrets de ces noms de lieux, il faut se tourner vers la toponymie, la science qui les étudie.
Les noms des localités que l’on connaît aujourd’hui n’ont évidemment pas tous été donnés à la même époque. Logiquement, les toponymes témoignent des langues parlées dans ces lieux, mais également de certaines modes. Chevenez, par exemple, est un nom de lieu dont l’origine remonte à l’époque gallo-romaine. Des fouilles réalisées en 2012 ont d’ailleurs permis de mettre au jour un site de période romaine remontant au Ier siècle après J.-C. Ce toponyme est composé d’un nom propre gallo-romain, Cavinius, auquel on ajoute le suffixe bien répandu -acum : Chevenez signifie donc « la propriété de Cavinius ».
Au VIe siècle, on crée des noms de lieux en utilisant le mot latin cohortem (« exploitation agricole, hameau ») que l’on retrouve sous la forme cour-. Lorsque l’élément se trouve au début du mot, comme dans Courroux ou Courtedoux, cela tend à signifier que le lieu a été fondé au début du VIe siècle. En revanche, si l’élément est situé en fin de mot, comme dans Bassecourt ou Bressaucourt, le village daterait plutôt de la fin VIe siècle. Au VIIe siècle, c’est l’adjectif latin villaris (« de la ferme ») qui entre en jeu, comme dans Villars, Epauvillers ou Montsevelier.
Et les noms propres avec article des Franches-Montagnes que l’on retrouve dans Les Breuleux, La Bosse Le Peuchapatte ou Les Pommerats ? Ils reflètent la colonisation tardive du haut-plateau. La langue latine n’avait pas d’article. Ces derniers apparaissent dans les langues romanes à partir des VIIIe-IXe siècles. Toutefois, cela ne signifie pas que ces villages soient aussi anciens. Les localités avec article des Franches-Montagnes ont probablement été fondées plus tard, à partir du XIe siècle. Les premières attestations dans des sources écrites apparaissent en 1330, avec Le Bémont, La Bosse, Les Enfers et Le Praisselet.
Élodie Paupe
Ferme traditionnelle
Élément essentiel du paysage des Franches-Montagnes, les fermes sont, comme lui, en constante mutation. Alors, « la » ferme traditionnelle franc-montagnarde existe-t-elle ?
Les fermes francs-montagnardes représentent des volumes plus bas que celles d’Ajoie ou de la vallée de Delémont. Les exemples les plus anciens conservés aujourd’hui datent des XVIe et XVIIe siècles. Très peu pentues, les toitures présentaient à l’origine, et c’est encore le cas pour une petite trentaine d’entre elles, quatre ou trois pans. C’est principalement dès le XVIIIe siècle que les nouvelles fermes se construisent sous un toit à deux pans ou que les plus anciennes « perdent » un pan ou deux, au gré des agrandissements. Ces toitures très peu pentues étaient couvertes de petites planches de bois appelées bardeaux. Ce n’est qu’au XXe siècle que les bardeaux sont remplacés par des tuiles à emboîtement, à l’exception de deux bâtiments : une ferme à deux pans à Muriaux et, bien entendu, le Musée rural jurassien aux Genevez.
Les façades principales se situent généralement au sud-ouest. Les façades nord-est sont les plus exposées et peuvent donc être recouvertes d’un revêtement de bois en forme de petites écailles appelées tavillons, de tuiles ou, plus récemment, d’amiante-ciment (Eternit). Les fermes sont souvent grandes et accueillent plusieurs familles. On parle alors de ferme double, voire de ferme triple.
Elles sont construites en pierre calcaire et crépies à la chaux. Parfois, le tiers supérieur du pignon arrière, voire du pignon avant, est couvert de planches de bois. On l’appelle la ramée. La grange haute est souvent accessible par un pont de grange, constitué par le terrain naturel ou aménagé artificiellement. Autour de la ferme, se trouvent traditionnellement une citerne pour récolter l’eau et la neige des toits, un jardin potager et un grenier de bois installé à l’origine face à la façade principale de la ferme, afin de pouvoir le surveiller.
Les fermes franc-montagnardes accueillent sous le même toit les espaces dévolus à l’agriculture (granges, étables, écuries, remises, parfois ateliers de transformation) et le logement des humains. C’est un vestibule, appelé devant-huis, qui sépare à l’intérieur les deux types d’espace. On y entre en général par une porte cochère, marquant fortement la façade. Certains espaces ont été transformés pour accueillir d’autres activités professionnelles exercées en plus du travail agricole : horlogerie, mécanique, artisanat, restauration. Le logement n’occupe quant à lui qu’une petite partie du volume, au maximum un tiers. On y trouve une cuisine voûtée dont le poêle communique avec la pièce d’à côté, appelée la belle chambre. Une autre chambre vient compléter l’aménagement intérieur. Parfois, une période particulièrement faste ou l’agrandissement de la famille ont poussé certains logements à s’étendre un peu dans la grange, avec l’ajout de chambres. Cette pratique a pris un fort essor ces dernières décennies où de nombreuses granges ont été transformées en logement. Enfin, la plupart des fermes possèdent également une cave voûtée. Dans les plus luxueuses, une grande table en pierre ancrée dans le sol conserve les aliments au frais aussi bien qu’un frigo.
Comme tous les bâtiments, les fermes franc-montagnardes ont donc connu de nombreuses transformations à travers les siècles, en raison de la famille qui s’agrandit, d’une situation économique qui s’améliore, des pratiques agricoles qui se modifient, de la vie professionnelle qui se diversifie, des goûts personnels, de la modification des modes de vie ou encore d’éléments extérieurs tels que des accidents ou des catastrophes.
Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques
Quelle évolution pour le pâturage boisé ?
Le pâturage boisé existe depuis plusieurs siècles sur la chaîne jurassienne. Pourtant, son existence est menacée: plusieurs d'entre eux sont depuis de nombreuses années confrontés à un problème de bipolarisation. D'un côté, les parties très boisées se referment à cause d'une intensité de pâture trop faible et redeviennent peu à peu de la forêt; de l'autre côté, les parties faiblement boisées deviennent à terme totalement nues et sans arbres. Ces écosystèmes sont-ils voués à disparaître?
En Suisse, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) relève une diminution des pâturages boisés. Le constat est le même en France. Cependant, des deux côtés de la frontière, ils sont jugés dignes de préservation.
L'évolution bipolaire observée sur une grande partie des pâturages boisés de l'Arc jurassien est inquiétante: sur les zones faiblement boisées et facilement accessibles, le rajeunissement n'a aucune chance à cause de la forte pression du bétail et aussi parfois de l'homme. Sur les parties plus éloignées et moins favorables à l'exploitation agricole, le boisement a tendance à se densifier. Outre les incidences négatives sur l'aspect paysager et la biodiversité, cette situation conduit à une diminution du potentiel fourrager et à un manque d'abris pour le bétail. Les causes de ce phénomène sont multiples: sur le plan agricole, on observe une diminution du nombre des exploitations et une augmentation de leur taille, ainsi qu'une diminution de la main-d'œuvre agricole. Sur le plan sylvicole, le marché du bois peu attractif conduit à une sous-exploitation des pâturages boisés et donc à une augmentation du volume de bois sur pied. Sur le plan politique, on a longtemps observé un manque de coordination entre les politiques agricoles et forestières. Ces dernières ne tenaient par ailleurs pas assez compte des spécificités du pâturage boisé. Cela est toutefois en train de changer.
Il n'est pas possible de dire si le pâturage boisé pourra perdurer à long terme ou pas. Cela dépendra des actions qui y seront entreprises ainsi que de l'évolution du contexte politico-économique. L'évolution du climat et l'impact que cela aura sur les pâturages boisés est également incertain. En contribuant toutes et tous à son maintien et en intégrant les effets du réchauffement climatique sur les arbres, le pâturage boisé devrait continuer d'exister, mais certainement avec un aspect quelque peu différent de celui que nous connaissons actuellement.
Texte tiré de la brochure L’essentiel sur les pâturages boisés, réalisée par le Parc Naturel Régional du Doubs, 4e édition en 2020. Pour la commander, rendez-vous sur le site Internet du Parc.
Pour aller plus loin
Vous pouvez lire l’article de Mélanie Oriet publié dans les Actes de la Société jurassienne d’émulation en 2011, « Le pâturage boisé franc-montagnard à la croisée des chemin : chronique d’un mort annoncée ou promesse d’un avenir meilleur ? »