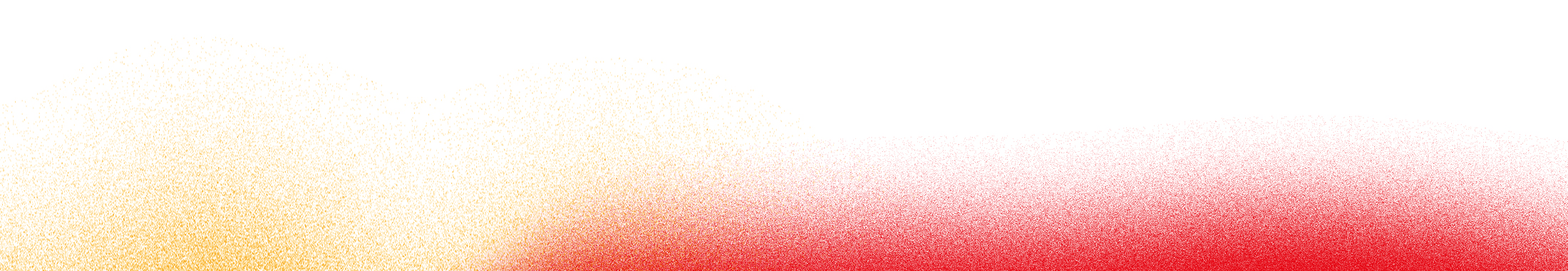Ce qu’aurait pu être le panorama
Derrière le cadre, le terrain s’élève encore de quelques mètres dans les champs. Devant le cadre, un plateau qui se perd dans les forêts. Si une place d’armes s’était construite dans les Franches-Montagnes, elle occuperait l’horizon.
À Courfaivre, une exposition réalisée par l’association Aux Arts! présente L’art de l’autonomie. Le premier espace de l’exposition est justement consacré aux travaux de Coghuf en lien avec le combat contre la place d’armes des Franches-Montagnes.
Exposition visible du 1er au 23 juin et du 31 août au 22 septembre. Plus d’informations.
Place d'arme des Franches-Montagnes
L’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes est un évènement marquant du XXe siècle dans les Franches-Montagnes. Dès 1955, le Département militaire fédéral s’intéresse à trois domaines agricoles qui se trouvent dans les communes de Lajoux, Les Genevez et Montfaucon. Ils prévoient de transformer ces 400-450 hectares en terrain dévolu à l’exercice de blindés. Le 3 décembre 1955, une assemblée extraordinaire est convoquée aux Genevez après qu’un agriculteur a informé le maire de ce projet. Les citoyens s’opposent à l’établissement d’une place d’armes et les communes voisines sont informées de la situation. Une rencontre est organisée à Berne et une pétition circule à travers les Franches-Montagnes qui témoigne de l’opposition des citoyens à l’établissement d’une place d’armes.
À la fin de l’année 1956, le Conseil fédéral renonce à poursuivre les démarches politiques et le canton de Berne rachète les domaines qui avait fait l’objet de pactes d’emption avec la Confédération. En 1962, le Département militaire fédéral revient à charge avec un projet plus compatible avec les sentiments franc-montagnards : la création d’un centre militaire du cheval, en d’autres termes l’ouverture d’un centre d’acclimatation pour les chevaux étranger et l’établissement d’une place d’armes pour les écoles de recrue de la cavalerie et du train. Seize communes de la Courtine et des Franches-Montagnes se prononcent sur le sujet par le biais des urnes : toutes s’y opposent. Malgré ce résultat, le canton de Berne cède les domaines à la Confédération. Des manifestations s’organisent, notamment les journées « Sauvez les Franches-Montagnes » qui rassemblent plusieurs milliers de personnes lors de chacune des cinq éditions.
En mars 1963 est fondé le Comité d’action contre l’établissement d’une place d’armes aux Franches-Montagnes et dans la Courtine. Le Front de libération du Jura apporte son soutien par différentes actions terroristes, notamment l’incendie de deux fermes rachetées par la Confédération la même année. Le 30 août 1964, une contre-manifestation initiée par le Rassemblement jurassien empêche le Conseiller fédéral Chaudet de prononcer aux Rangiers son allocution pour la commémoration des deux mobilisations. Parmi les Jurassiens qui font le déplacement, on trouve des béliers, mais aussi des opposants au projet de la place d’armes. Comme le souligne Emmanuel Gogniat, « la manifestation des Rangiers engage définitivement le problème de la place d’armes dans la cause séparatiste ». Le Département militaire fédéral renonce à son projet en 1969 et les communes rachètent les fermes à la Confédération en 1976. Le 1er mai 1981, les deux fermes incendiées par le FLJ et reconstruites sont inaugurées.
Élodie Paupe, responsable du site Jura-24 des Franches-Montagnes
Pour aller plus loin
Gogniat Emmanuel, Aux racines du patriotisme. Affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes et Question jurassienne (1956-1976), mémoire de licence, Université de Genève, 2003.
Crevoisier Benoîte, Le bras de fer. Regard d’une militante sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes, Neuchâtel : Alphil, 2019.
L’autrice Sara Schneider a publié cette année un roman de littérature fantastique intitulé Place d’Âmes et consacré à ce sujet. L’ouvrage est à découvrir et à commander dans les librairies de la région ou sur le site de l’éditeur, PVH éditions.
Place d’Âmes est également disponible gratuitement sous forme de livre audio.
Cultiver des céréales aux Franches-Montagnes
Par les siècles passés, l’existence de moulins atteste de cultures de céréales pour la farine à Soubey, aux Breuleux, aux Bois, à L’étang de Plain de Saigne dont les maitres-meuniers répondaient au doux nom de Farine !
La production de céréales s’est toujours pratiquée dans les Franches-Montagnes mais sur des surfaces très restreintes, avec, en général, pour objectif principal de rénover les prairies de fauche. Les céréales fourragères de printemps (avoine et orge) étaient principalement cultivées jusque dans les années 1980. Ensuite, les premières variétés de triticale d’automne, très rustiques, ont été cultivées avec succès.
Plus tard, d’autres céréales d’automne ont été mises en culture comme le blé fourrager, l’orge et finalement le blé panifiable. Avec les changements climatiques, les hivers plus doux et l’allongement de la période de végétation, la production de céréales permet actuellement d’obtenir des rendements quasi comparables à ceux de la plaine. Par ailleurs, avec les innovations techniques telles que le semis direct et le travail du sol réduit, il est devenu plus aisé de cultiver des céréales dans nos sols souvent pierreux et superficiels.
La production de céréales sur place a pour avantages d’augmenter l’autonomie fourragère des exploitations agricoles, de faciliter la rénovation des prairies et de diminuer les besoins d’importation en paille de litière pour les animaux d’élevage. Elle permet également d’augmenter la production végétale à destination alimentaire comme le veut la politique agricole actuelle.
La part des cultures de céréales dans la surface agricole utile est passée de 2.4% en 2010 à 3.3% en 2022. Parmi ces céréales, le blé est passé de 10 à 20%.
Julien Berberat, Fondation Rurale Interjurassienne
Quels seront les impacts des changements climatiques sur les forêts jurassiennes?
Les changements climatiques impactent déjà abondamment les forêts jurassiennes, avec des effets positifs comme négatifs. A l’avenir, les incendies forestiers seront plus fréquents, tous comme probablement les dégâts dus aux ravageurs, conséquence de la hausse des températures de l’air et de l’augmentation du nombre et de l’intensité de périodes caniculaires. Les dégâts dus aux chaleurs excessives et à la sécheresse impactent les jeunes arbres avant tout. Les forêts devraient tendre à être moins denses et donc à stocker moins de CO2 qu’actuellement. En outre la qualité des bois indigènes devrait globalement diminuer et donc poser des problèmes pour la sylviculture.
Les tempêtes, plus généralement tous les types de phénomènes météorologiques extrêmes, seront également plus fréquents et plus intenses. Les événements tels qu’éboulement et chutes de pierre devraient également tendre à augmenter en conséquence. Les risques de gel printaniers tendent aussi à augmenter en montagne (>800m.).
Il existe toutefois des aspects positifs en conséquence à la hausse des températures de l’air. Les dommages causés par la pression de la neige vont continuer de diminuer avec la raréfaction des précipitations sous forme neigeuse, et la période de végétation continuera de s’allonger progressivement à l’avenir.
L’ampleur des problèmes susmentionnés dépendra évidemment des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, plus ceux-ci seront élevés, plus les changements climatiques seront problématiques pour la biodiversité.
Il y a des espèces gagnantes pour lesquels les changements climatiques sont bénéfiques, comme globalement les espèces de chênes et aulnes. Des espèces sont quant à elles perdantes, petit à petit plus adaptées au climat qui se réchauffe. C’est le cas du hêtre (Fagus sylvatica) et de l’épicéa (Picea abies. Leur aire de répartition se limitera probablement aux crêtes du Jura d’ici la fin du siècle. En effet, ces deux espèces souffrent particulièrement de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de sècheresses estivales, accompagnées de températures très élevées qui assèchent rapidement les sols et les arbres. Les hêtres ont alors tendance à sécher et mourir, alors que les épicéas sont ravagés par le bostryche durant les canicules estivales.
Ces espèces verront donc leurs aires de répartition décliner progressivement au profit d’autres espèces.
L’équipe du professeur Zimmermann (WSL) a auparavant effectué des travaux semblables sur différentes espèces et périodes, ci-dessous l’exemple pour l’épicéa :
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL.
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL.
Valentin Comte, climatologue, CEDD-Agro-Eco-Clim
Pour aller plus loin
L’institut fédéral de recherches sur la neige, la forêt et le paysage (WSL) a mis au point une plateforme qui permet de voir quels sont les aires possibles de répartition des principales espèces d’arbres forestiers à l’avenir en Suisse.