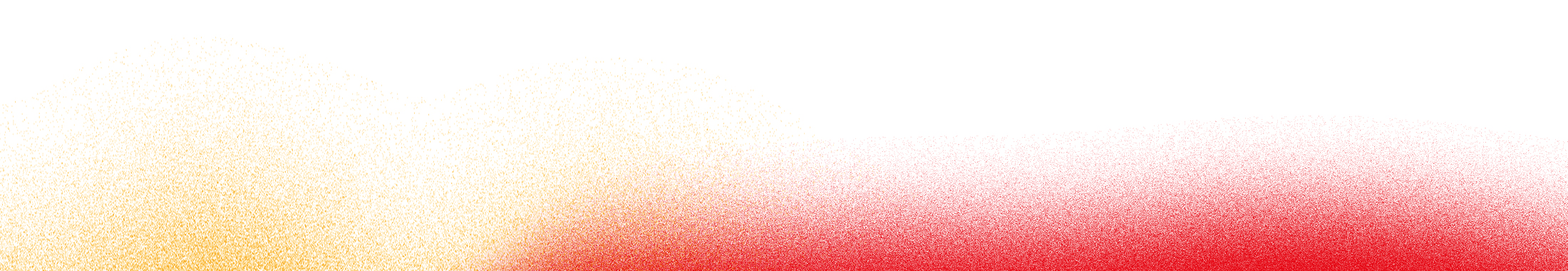Le Peu Girard
Avez-vous noté que vous avanciez sur un sentier de randonnée équestre? Il faut dire que l’agritourisme est en pleine expansion.
Nous quittons les crêtes pour descendre vers Les Breuleux. Deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez suivre la route (balisage Jura-24) ou remonter jusqu’au hameau pour suivre le balisage jaune. Si vous choisissez la deuxième option, prenez garde au bétail qui se trouve en liberté, y compris un taureau, et gardez vos distances.
Les fermes traditionnelles des Franches-Montagnes
En complément au panneau qui se trouve derrière vous, à côté du banc, quelques informations sur l’architecture agricole typique des Franches-Montagnes.
Élément essentiel du paysage des Franches-Montagnes, les fermes sont, comme lui, en constante mutation. Alors, « la » ferme traditionnelle franc-montagnarde existe-t-elle ?
Les fermes francs-montagnardes représentent des volumes plus bas que celles d’Ajoie ou de la vallée de Delémont. Les exemples les plus anciens conservés aujourd’hui datent des XVIe et XVIIe siècles. Très peu pentues, les toitures présentaient à l’origine, et c’est encore le cas pour une petite trentaine d’entre elles, quatre ou trois pans. C’est principalement dès le XVIIIe siècle que les nouvelles fermes se construisent sous un toit à deux pans ou que les plus anciennes « perdent » un pan ou deux, au gré des agrandissements. Ces toitures très peu pentues étaient couvertes de petites planches de bois appelées bardeaux. Ce n’est qu’au XXe siècle que les bardeaux sont remplacés par des tuiles à emboîtement, à l’exception de deux bâtiments : une ferme à deux pans à Muriaux et, bien entendu, le Musée rural jurassien aux Genevez.
Les façades principales se situent généralement au sud-ouest. Les façades nord-est sont les plus exposées et peuvent donc être recouvertes d’un revêtement de bois en forme de petites écailles appelées tavillons, de tuiles ou, plus récemment, d’amiante-ciment (Eternit). Les fermes sont souvent grandes et accueillent plusieurs familles. On parle alors de ferme double, voire de ferme triple.
Elles sont construites en pierre calcaire et crépies à la chaux. Parfois, le tiers supérieur du pignon arrière, voire du pignon avant, est couvert de planches de bois. On l’appelle la ramée. La grange haute est souvent accessible par un pont de grange, constitué par le terrain naturel ou aménagé artificiellement. Autour de la ferme, se trouvent traditionnellement une citerne pour récolter l’eau et la neige des toits, un jardin potager et un grenier de bois installé à l’origine face à la façade principale de la ferme, afin de pouvoir le surveiller.
Les fermes franc-montagnardes accueillent sous le même toit les espaces dévolus à l’agriculture (granges, étables, écuries, remises, parfois ateliers de transformation) et le logement des humains. C’est un vestibule, appelé devant-huis, qui sépare à l’intérieur les deux types d’espace. On y entre en général par une porte cochère, marquant fortement la façade. Certains espaces ont été transformés pour accueillir d’autres activités professionnelles exercées en plus du travail agricole : horlogerie, mécanique, artisanat, restauration. Le logement n’occupe quant à lui qu’une petite partie du volume, au maximum un tiers. On y trouve une cuisine voûtée dont le poêle communique avec la pièce d’à côté, appelée la belle chambre. Une autre chambre vient compléter l’aménagement intérieur. Parfois, une période particulièrement faste ou l’agrandissement de la famille ont poussé certains logements à s’étendre un peu dans la grange, avec l’ajout de chambres. Cette pratique a pris un fort essor ces dernières décennies où de nombreuses granges ont été transformées en logement. Enfin, la plupart des fermes possèdent également une cave voûtée. Dans les plus luxueuses, une grande table en pierre ancrée dans le sol conserve les aliments au frais aussi bien qu’un frigo.
Comme tous les bâtiments, les fermes franc-montagnardes ont donc connu de nombreuses transformations à travers les siècles, en raison de la famille qui s’agrandit, d’une situation économique qui s’améliore, des pratiques agricoles qui se modifient, de la vie professionnelle qui se diversifie, des goûts personnels, de la modification des modes de vie ou encore d’éléments extérieurs tels que des accidents ou des catastrophes.
Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques
Tourisme équestre
Depuis très longtemps, l’équitation se faisait naturellement avec les chevaux de la région utilisés dans l’agriculture et l’élevage, les enfants les montaient à cru pour s’amuser. Dès les années 60, de nombreux cavaliers locaux ou extérieurs sillonnaient les Franches-Montagnes perçues comme un paradis pour les balades équestres. C’est en 1999 que l’histoire des réseaux équestres a officiellement débuté dans le Canton du Jura avec la création de l’association réseau équestre Franches-Montagnes (AREF), qui aujourd’hui compte plus de 300 kilomètres de pistes balisées pour la randonnée équestre dans les Franches-Montagnes et environs. S’en sont suivi entre 2016 et 2023, plus de 700 nouveaux kilomètres développés dans le cadre du projet de développement régional Marguerite dans les districts d’Ajoie et Delémont pour former une entité jurassienne Association Réseaux Equestres Jura et environs (AREJ). En plus de bénéficier de l’unique race chevaline d’origine suisse, le Jura peut se positionner fièrement comme destination équestre par excellence avec plus de 1'000 km de réseau équestres à disposition des cavaliers intéressés à venir découvrir notre belle région.
Les cavaliers peuvent les découvrir sur une ou plusieurs journées et s’arrêter le long des réseaux chez différents prestataires de restauration, de vente directe ou d’hébergement. Les réseaux disposent d’infrastructures modernes pour le confort des cavaliers avec notamment plus de 250 barrières équestres qui ont été installées ainsi que des barres d’attache dans différents lieux d’accueil.
L’entretien des réseaux équestres sont financés notamment grâce à l’encaissement des taxes, des cotisations des membres de l’association ainsi que d’une subvention cantonale.
Le site de l’association Réseau Equestre Jura et environs vous renseigne sur les itinéraires existants ainsi que sur les prestataires de services : www.arej.ch
Geneviève Sahy Wille, Présidente de l’Association Réseau Equestre Jura et environs (AREJ). AREF Réseau équestre des Franches-Montagnes et environs.
Urbanisme horloger
Dès la fin du 17e siècle, l’horlogerie se développe dans l’Arc jurassien, donnant lieu au mythe du paysan-horloger qui, pendant les longs mois d’hiver, s’adonne à la fabrication de la montre, installant un établi à l’une des fenêtres de sa maison rurale.
Graduellement, cette proto-industrie, source de revenu complémentaire, devient une activité professionnelle à part entière. Se développent alors une multitude d’ateliers indépendants, hautement spécialisés, qui travaillent en réseau selon un système dit de l’« établissage ». De la fabrication des composants du mouvement à la décoration de la boîte de montre, une pléiade d’entreprises de petite taille entre donc en jeu, jusqu’à la mise en vente finale du garde-temps.
Au 19e siècle, l’essor de l’horlogerie est phénoménal. Dans les Montagnes neuchâteloises, les villes du Locle et surtout de La Chaux-de-Fonds deviennent des hauts lieux de la fabrication et de la commercialisation de la montre à l’échelle mondiale. Leur succès est tel que dans les années 1880, ces localités peinent entendre les voix qui s’élèvent en faveur d’une réorganisation de la branche et une modernisation des modes de fabrication, pour contrer, tout particulièrement, la production en série qui se développe à toute vitesse de l’autre côté de l’Atlantique.
Dans cette ère des fabriques qui s’amorce, le Jura se montre ouvert aux possibilités de la mécanisation, et devient une terre d’accueil pour les nouveaux industriels. Des usines voient le jour, permettant la concentration de la main d’œuvre, la mécanisation, et la réalisation d’éléments standardisés. L’accès à la lumière naturelle reste néanmoins essentiel pour cette industrie de précision, et les fabriques dernier cri se distinguent par leurs longues rangées de baies vitrées à chaque étage, rendues possibles par l’amélioration des techniques constructives, dont le recours croissant au béton armé.
Dès l’origine, l’horlogerie, qui ne cause pas de nuisance, peut côtoyer sans difficulté les hauts lieux de la vie quotidienne. La mixité des lieux de production et des lieux de vie constitue une caractéristique principale de l’urbanisme horloger. Aujourd’hui encore, l’horlogerie s’intègre harmonieusement dans le tissu urbain du canton, rappelant la riche tradition artisanale et industrielle de la région.
Marikit Taylor