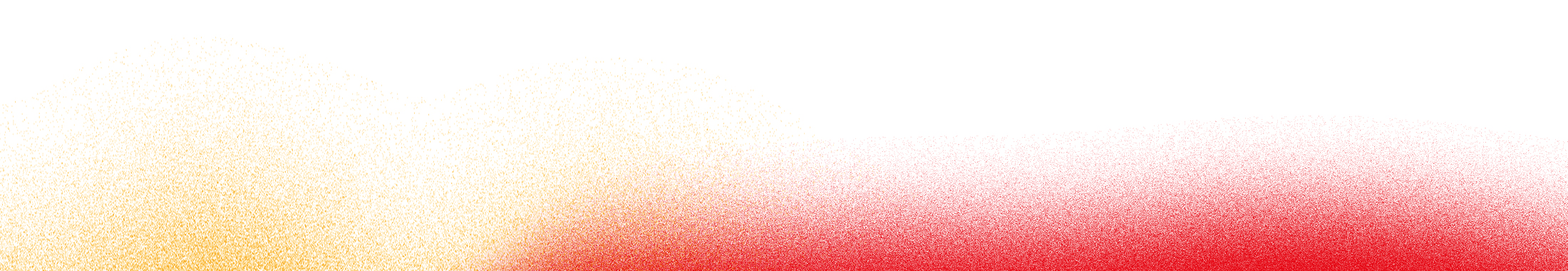Un patrimoine paysager en évolution
Ce dernier cadre vous invite à regarder au loin. Quels éléments emblématiques du paysage franc-montagnard voyez-vous?
Des épicéas, des murs en pierres sèches et, si vous avez de la chance, quelques animaux. Il ne manque qu’une ferme traditionnelle pour compléter ce paysage. Les paysages que vous allez traverser pour rejoindre Saignelégier sont caractéristiques des pâturages boisés.
Murs en pierres sèches
Les murs de pierres sèches sont des éléments marquants du paysage de la chaîne jurassienne. Ils représentent également des milieux précieux pour de nombreux êtres vivants. Ils sont composés de pierres brutes qui sont superposées de manière à ce qu'elles forment un mur stable et solide, sans mortier. À l'origine, les pierres utilisées étaient généralement ramassées à proximité ou récoltées dans des petites carrières locales.
La construction d'un mur de pierres sèches nécessite un certain savoir-faire. En principe, la hauteur du mur représente le double de la largeur de ses fondations et sa base est plus large que son sommet. Plusieurs types de pierres sont nécessaires; elles doivent être disposées selon une technique particulière puisqu'aucune forme de ciment ou de mortier ne les soude. Les pierres sont prélevées dans la région, dans des couches géologiques particulières. Ces structures abritent également une grande diversité d'êtres vivants (p. ex. des reptiles, des insectes, des escargots, certaines plantes comme des mousses, des orpins ou des lichens).
Un mur contient des espèces différentes sur le côté exposé au sud (sec et chaud) et sur le côté nord (plus froid et humide). Il assure également la fonction de liaison entre différents biotopes et constitue un des éléments des projets de réseaux écologiques.
Les murs de pierres sèches sont menacés de disparition, car ils sont de plus en plus souvent laissés à l'abandon. Heureusement diverses associations œuvrent dans le but de maintenir et de reconstruire ces structures typiques du paysage jurassien.
Texte tiré de la brochure L’essentiel sur les pâturages boisés, réalisée par le Parc Naturel Régional du Doubs, 4e édition en 2020. Pour la commander, rendez-vous sur le site Internet du Parc.
Pâturage boisé
Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert. Ils constituent aussi bien une base de production (agricole et sylvicole) qu'un lieu à haute valeur environnementale et un espace de détente et de loisirs. Lieu de transition entre la forêt et les zones ouvertes, ils abritent une multitude d'espèces végétales et animales.
Typiques de la chaîne jurassienne, les pâturages boisés sont répartis sur tout le massif, majoritairement entre 900 et 1400 m d'altitude. Ils trouvent leur origine au Moyen Âge, lorsque ces zones, couvertes alors de forêts denses, commencèrent à être colonisées. Pour pouvoir s'y installer et y survivre, les colons ont entrepris le défrichement des forêts, faisant paître leur bétail sur les surfaces ainsi gagnées. Souvent, les zones favorables à la pousse de l'herbe étaient déboisées, tandis que le boisement était maintenu sur les parties très caillouteuses et/ou pentues. Au fil du temps, le bétail a progressivement éliminé certaines espèces végétales, préférant les tendres feuilles du hêtre aux aiguilles piquantes de l'épicéa.
Traditionnellement, les pâturages boisés sont utilisés pour produire du fourrage et du bois. L'agriculteur est rarement propriétaire du pâturage boisé, le plus souvent ce dernier appartient à une collectivité publique (commune ou bourgeoisie). L'herbage est alors exploité par plusieurs agriculteurs (appelés «ayants droit» dans les Franches-Montagnes), tandis que le propriétaire du pâturage s'occupe de la gestion du bois. Les agriculteurs de la région bénéficient du droit d'y mettre paître des bêtes selon un système de répartition qui varie d'un pâturage à l'autre; ce droit peut être appelé «encranne», «droit de pacage» ou simplement «droit». En contrepartie, les agriculteurs paient une taxe et/ou effectuent des travaux d'entretien sur les pâturages (appelés parfois aussi corvées).
Les pâturages boisés offrent un habitat riche et varié à de nombreuses plantes et à de nombreux animaux, qui y trouvent nourriture, abris et territoires. Depuis quelques décennies, ils sont de plus en plus prisés pour des activités de loisirs ainsi que pour leur aspect paysager. Un nombre croissant de personnes s'y délassent. Par ailleurs, le pâturage boisé représente une valeur identitaire forte pour les habitants de l'Arc jurassien.
Texte tiré de la brochure L’essentiel sur les pâturages boisés, réalisée par le Parc Naturel Régional du Doubs, 4e édition en 2020. Pour la commander, rendez-vous sur le site Internet du Parc.
Quels seront les impacts des changements climatiques sur les forêts jurassiennes?
Les changements climatiques impactent déjà abondamment les forêts jurassiennes, avec des effets positifs comme négatifs. A l’avenir, les incendies forestiers seront plus fréquents, tous comme probablement les dégâts dus aux ravageurs, conséquence de la hausse des températures de l’air et de l’augmentation du nombre et de l’intensité de périodes caniculaires. Les dégâts dus aux chaleurs excessives et à la sécheresse impactent les jeunes arbres avant tout. Les forêts devraient tendre à être moins denses et donc à stocker moins de CO2 qu’actuellement. En outre la qualité des bois indigènes devrait globalement diminuer et donc poser des problèmes pour la sylviculture.
Les tempêtes, plus généralement tous les types de phénomènes météorologiques extrêmes, seront également plus fréquents et plus intenses. Les événements tels qu’éboulement et chutes de pierre devraient également tendre à augmenter en conséquence. Les risques de gel printaniers tendent aussi à augmenter en montagne (>800m.).
Il existe toutefois des aspects positifs en conséquence à la hausse des températures de l’air. Les dommages causés par la pression de la neige vont continuer de diminuer avec la raréfaction des précipitations sous forme neigeuse, et la période de végétation continuera de s’allonger progressivement à l’avenir.
L’ampleur des problèmes susmentionnés dépendra évidemment des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, plus ceux-ci seront élevés, plus les changements climatiques seront problématiques pour la biodiversité.
Il y a des espèces gagnantes pour lesquels les changements climatiques sont bénéfiques, comme globalement les espèces de chênes et aulnes. Des espèces sont quant à elles perdantes, petit à petit plus adaptées au climat qui se réchauffe. C’est le cas du hêtre (Fagus sylvatica) et de l’épicéa (Picea abies. Leur aire de répartition se limitera probablement aux crêtes du Jura d’ici la fin du siècle. En effet, ces deux espèces souffrent particulièrement de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de sècheresses estivales, accompagnées de températures très élevées qui assèchent rapidement les sols et les arbres. Les hêtres ont alors tendance à sécher et mourir, alors que les épicéas sont ravagés par le bostryche durant les canicules estivales.
Ces espèces verront donc leurs aires de répartition décliner progressivement au profit d’autres espèces.
L’équipe du professeur Zimmermann (WSL) a auparavant effectué des travaux semblables sur différentes espèces et périodes, ci-dessous l’exemple pour l’épicéa :
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL.
Source : PorTree, Niklaus Zimmermann, WSL.
Valentin Comte, climatologue, CEDD-Agro-Eco-Clim
Pour aller plus loin
L’institut fédéral de recherches sur la neige, la forêt et le paysage (WSL) a mis au point une plateforme qui permet de voir quels sont les aires possibles de répartition des principales espèces d’arbres forestiers à l’avenir en Suisse.