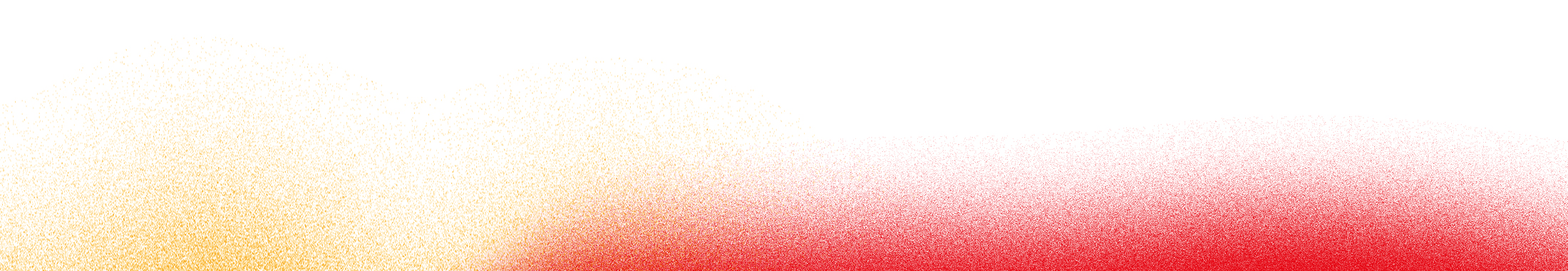Saignelégier
Deux points de vue pour ce premier cadre. D’un côté, Saignelégier et son emblématique halle du marché-concours, de l’autre une ferme jurassienne.
En 1897 s’organise le premier Marché-Concours de Saignelégier, qui deviendra la vitrine par excellence de l’élevage du cheval des Franches-Montagnes. “La détermination des Francs-Montagnards s'est d’ailleurs manifestée dès les origines de cette manifestation, puisque la commune de Saignelégier investit une somme considérable dans la construction d'une immense halle-cantine en 1904 déjà. Elle reste la figure emblématique de Saignelégier et du Marché-Concours.”
Informations tirées de la fiche consacrée à l’élevage du cheval des Franches-Montagnes, reconnue comme une tradition vivante pour les cantons de Berne et du Jura.
Élevage chevalin aux Franches-Montagnes
De quand datent les premières histoires de chevaux aux Franches-Montagnes ? La possession d'un cheval était considérée comme un signe d'honneur dans la Principauté de Bâle. Ainsi l'évêque Jean Senn prescrit en 1351 :
Celui qui veut être reçu bourgeois de Bâle devra être pourvu plusieurs années auparavant de chevaux et de certificats d'honnêteté. Si le prélat consent à le recevoir après sa demande, le suppliant viendra avec 3 chevaux en bon état ; si la demande est agréée, il retournera à pied ou l'évêque pourra lui en laisser un .
Parmi les chevaux fournis aux princes autrichiens par les seigneurs suisses aux XIIIe et XIVe siècles, un certain nombre provenaient de l'Évêché de Bâle comme l'indique G. Carnat (1934).
En 1619, un certain Andreas Forster déclara lors d'une discussion à la cour épiscopale de Bâle :
Les chevaux des Franches-Montagnes dépassent tous les autres en beauté : ils sont robustes et résistants. Malheureusement, ils ont la tête lourde et deviennent facilement aveugles.
En 1754, le prince-évêque Joseph désirant acheter des chevaux aux Franches-Montagnes, proposa de placer 5 de ses étalons dans la région pour améliorer l'élevage. Le bailli répondit après avoir consulté les détenteurs des juments :
Les paysans ne croient pas à votre providence paternelle et pensent qu'il y a quelque chose là-dessous.
Au temps où le Jura était un département français, un recensement lié à la campagne militaire engagée par la France contre l'Autriche donne les résultats suivants : 30 chevaux à Epauvillers, 325 à St-Brais et 542 à Saignelégier.
En 1818, le premier concours cantonal de chevaux est organisé à Saignelégier. En 1823, les Franches-Montagnes comptent le plus grand nombre de juments (1050) de tous les districts du canton de Berne. Actuellement, environ 1’500 chevaux sont recensés dans les Franches-Montagnes.
Quelles sont les lignées et leur évolution ?
Dès la moitié du XIXe siècle et durant plus d'un siècle, l'élevage chevalin connaîtra différentes phases successives et distinctes dans son évolution. Des apports de sang étrangers ont notamment été pratiqués à réitérées reprises. Depuis la tenue des premiers livres généalogiques, 28 familles sont répertoriées. La plus nombreuse, celle de l’étalon Vaillant, né en 1891 aux Communances, s’est subdivisée en lignées classifiées selon le nom du mâle reproducteur le plus important, à savoir : D = Drapeau, E = Eglon, H = Héroïque, R = Raceur, V = Verdict. De la famille d’Imprévu, seule la lignée C (Chasseur-Jurassien) a perduré. A ces six familles anciennes, cinq autres sont venues s’ajouter dans le courant du XXe siècle, soit celles de Doktryner (arabe), L = Alsacien et P = Nelson (demi-sang suédois), N = Noé et Q = Qui-Sait (demi-sang suisses). Certaines lignées comme les D, les P , les Q, les R et les V sont menacées de disparition, ce qui réduit la diversité génétique.
Buts d'élevage actuel ?
Le cheval FM doit être noble, typé, de taille moyenne, harmonieux dans ses proportions, performant, sociable et bien adapté au marché ; il doit être moyennement lourd, disposer d'une impulsion naturelle, avec des allures souples, correctes et sûres. Vu son excellent caractère, sa prédisposition aux performances, son aptitude à l’attelage et à l’équitation ainsi que sa fécondité, sa robustesse, sa précocité et sa sobriété, le cheval FM est très polyvalent : il convient aussi bien pour le sport, les activités de loisirs et l’équithérapie, que pour l’agriculture et l'armée.
Pourquoi la seule race d'origine suisse ?
La race des Franches-Montagnes est la seule d'origine suisse à avoir résisté aux profondes mutations intervenues dans l'utilisation et la sélection du cheval durant le 20e siècle. Comment l'expliquer ? Vu l'altitude, le climat et la topographie de la région, la culture fourragère a toujours prédominé dans les Franches-Montagnes ; l'élevage de chevaux de trait léger, très mobiles et harmonieux, a toujours été favorisé, alors que les régions de plaine élevaient des chevaux de trait lourd; les éleveurs francs-montagnards ont fait preuve d'une constance remarquable en matière de buts d'élevage ; la composition du sol et de la roche calcaire a exercé une influence sur la solidité du cheval et la qualité de son ossature ; les pâturages boisés, grands espaces disponibles pour les poulains, ont contribué à la qualité de leurs allures, à leur robustesse et à leur santé. Enfin, il est probable que l'assiduité, la patience, la persévérance dont font preuve les éleveurs, ainsi que leur recherche de la beauté, de la noblesse, du chic auxquels ils aspirent soient un héritage du paysan-horloger.
Bernard Beuret, président de l'association Identité Franches-Montagnes, ancien président de la Fédération suisse du Franches-Montagnes (FSFM), ancien chef du Service de l'économie rurale.
Pour aller plus loin
L’élevage du cheval des Franches-Montagnes est reconnu comme une tradition vivante pour les cantons du Jura et de Berne. Consultez la fiche.
Aux origines de la Tête de Moine
Appréciée des gourmets du monde entier, la Tête de moine a une très longue histoire, du Moyen Âge à nos jours.
Du fromage de Bellelay à la Tête de moine
Dès le 14e siècle, les chanoines de Bellelay produisent un fromage à pâte dure ou mi-dure. Il s’agit déjà d’un produit de qualité, qui doit être mûri au minimum de quatre à six mois. À cette époque, il peut être indifféremment fabriqué avec du lait de vache ou de brebis. Au 15e siècle, apparaît la dénomination « fromage de Bellelay » (en latin : caseus Bellelagiae). Il figure parmi les plus chers vendus alors au marché de Bâle. L’abbé en offre en cadeau aux puissants personnages dont il souhaite obtenir la faveur.
Jusqu’à la Révolution française, les chanoines produisent ce fromage sur leurs terres. En été 1778, Malesherbes, homme d’Etat et polygraphe français, décrit le travail des fromagers salariés par l’abbaye dans la vacherie de Béroie. Mais le couvent n’a pas le monopole de la production, et d’autres métairies de la région en fabriquent également au 18e siècle. Cela explique comment la Tête de moine a survécu à la disparition de l’abbaye. Vers 1800, la Tête de moine avait déjà la même forme qu’aujourd’hui, mais est nettement plus grosse, puisqu’elle pèse environ 5-6 kg.
On raconte que le nom de Tête de moine aurait été inventé à la Révolution française, dans une intention satirique. Il n’en est rien, car il est déjà attesté en 1783 dans les comptes de la cuisine du prince-évêque de Bâle – peu suspect d’anticléricalisme…
Moinillon chapardeur et girolle
Depuis quand racle-t-on la Tête de moine ? La légende veut qu’un moinillon trop gourmand ait décalotté un fromage, raclé quelques « fleurs », puis remis la calotte afin de cacher son larcin. Surpris en flagrant délit, il est absous par l’abbé, enthousiasmé par les avantages gustatifs de cette nouvelle méthode ! En réalité, cette pratique est tardive, car les auteurs qui parlent du fromage de Bellelay jusqu’au début du 19e siècle ne précisent jamais qu’il faut le consommer en le raclant. Elle est probablement apparue dans le courant du siècle, favorisée par la réduction de la taille de la meule. L’invention de la girolle en 1982 facilite grandement la réalisation des « fleurs » et contribue de façon décisive à l’extraordinaire essor des ventes de la Tête de moine, en Suisse comme à l’étranger.
Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle à Porrentruy
Café du Soleil
Depuis ici, on devine plutôt qu’on ne voit vraiment le Café du Soleil, caché derrière la Halle du Marché-Concours. Difficile de faire l’impasse sur cet établissement emblématique des Franches-Montagnes.
Établi dans une ancienne ferme transformée en café, Le Soleil est avant tout un lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants de la région. Le Café du Soleil a été ouvert en 1980 par un groupe de six amis à Saignelégier, artistes et “acharnistes”. Il a pour but de « promouvoir un lieu de rencontres, d'animation régionale, d'échange d'idées et d'entraide sous toutes les formes possibles, spécialement en relation avec la vie des Franches-Montagnes ».
Avec le temps, Le Soleil s’impose comme le lieu culturel des Franches-Montagnes. L’art s’expose dans la grande salle à manger du restaurant, tandis que la salle de l’étage vit au rythme d’une programmation riche et large. L’Espace culturel du Café du Soleil est par ailleurs reconnu comme centre culturel pour les Franches-Montagnes par le canton du Jura.