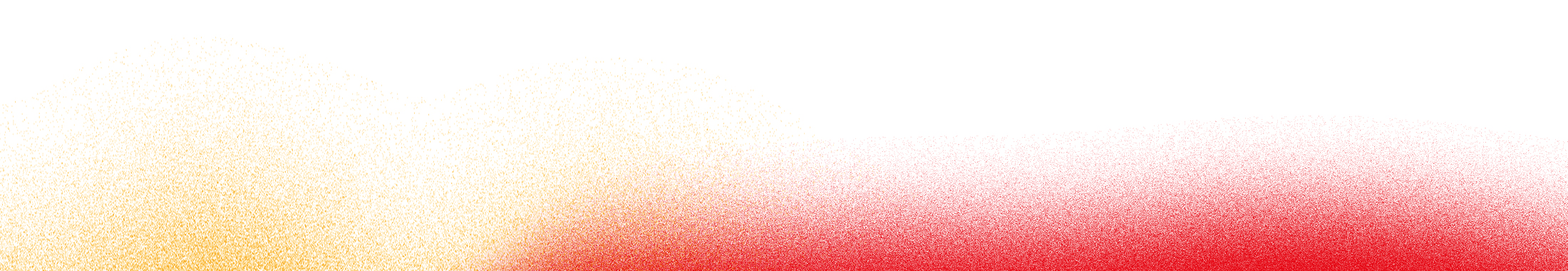Naissance d'une iconographie du paysage en Suisse et dans les Franches-Montagnes
Arnold Böcklin
Les Pins, 1949
Huile sur toile
76.8 x 74.6 cm
Inv. 1402
Kunstmuseum Basel, legs Clara Böcklin, 1923
Facsimilé
La nature et ses reliefs, tantôt majestueux ou menaçants, ont toujours stimulé et intrigué les personnalités visionnaires, artistiques ou aventurières qui ont façonné leurs représentations.
Cette tendance, toujours actuelle, ne se dément pas si l’on en croit l’engouement autour des aventuriers de l’extrême, qui, à la suite des iconiques Ella Maillart, Annemarie Schwarzenbach ou encore Nicolas Bouvier, se sont confrontés à l’inhospitalité des éléments et aux hasards du voyage. Dans cette même lignée, il est impossible de ne pas citer leurs alter ego contemporains, tels que Sarah Marquis, Sylvain Tesson ou encore l’indétrônable Mike Horn.
Cependant, les pionniers de l’exploration en quête de sensations fortes ne doivent pas être recherchés au détour d’un chemin escarpé de la Cordillère des Andes, ni au fin fond d’un désert gelé de Sibérie. C’est bien en Suisse, dans ses montagnes, que les premiers aventuriers, les touristes anglais, sont partis à la conquête des Alpes dès le 18e siècle.
Jusqu’alors, la nature et les montagnes sont perçues comme menaçantes par les autochtones helvétiques, car selon la croyance populaire, leurs sommets servaient de repaire aux dragons qui y avaient élu domicile, y pondaient leurs œufs et perpétuaient ainsi leur colonisation.
Les premiers touristes anglais ont donc vaillamment arpenté la moyenne montagne, tel que le massif du Jura, dont les Franches-Montagnes, avant de s’aventurer sur des sommets alpins suisses plus périlleux. Les artistes se sont naturellement fait l’écho de ces découvertes en dépeignant ces paysages spectaculaires à la fois majestueux et menaçants, que les spectateurs pouvaient contempler en toute quiétude dans leur salon feutré, bien loin des périls alpins.
Un peu plus tard, au tournant de la première moitié du 19e siècle, l’année 1848 fait figure de pierre angulaire marquant la naissance de la Suisse moderne avec l’entrée en vigueur de la première Constitution fédérale.
Suivant cet élan de modernité, les artistes concourent également à l’unification symbolique de ce que l’on pourrait qualifier de « pays de l’impossible ». En effet, il connaît quatre langues nationales et des sensibilités culturelles pouvant parfois sembler, au premier abord, hétéroclites. C’est dans ce contexte que les artistes posent les fondamentaux d’une identité iconographique dans laquelle l’ensemble des citoyens helvétiques peuvent se projeter et s’identifier. C’est la naissance du paysage suisse.
Ces symboles, qui deviennent très populaires à l’époque, et ce même hors des frontières, dans les régions urbaines et les capitales européennes, font la place belle aux reliefs typiquement suisses que l’on retrouve aux quatre coins du pays.
C’est alors que s’imposent comme icônes indéfectibles, les lacs, les montagnes et naturellement les sapins.
Cette nouvelle tendance de la peinture de paysage consiste à redécouvrir et à mettre un coup de projecteur sur des aperçus de vie rurale, parfois idéalisée, tels que des vaches menées aux champs, des paysages dépeignant une nature préservée, idyllique et paisible, incarnant parfois des traits de caractère propres aux Helvètes.
À ce jour, un vibrant témoignage de cette mécanique de la construction du paysage suisse et régional, par le prisme des Franches-Montagnes, a été dépeint par l’un des peintres romantiques suisses majeurs, Arnold Böcklin (Les Pins, 1849), qui se serait rendu dans les Franches-Montagne afin de capturer, pour la postérité, l’essence de son paysage puissant de contraste et mettant en scène un groupe d’arbres majestueux (les iconiques épicéas), se dressant dans le ciel couchant embrasé qui ont concouru à s’imposer comme symbole local et national indétrônable.
Sophie Vantieghem, historienne de l’art