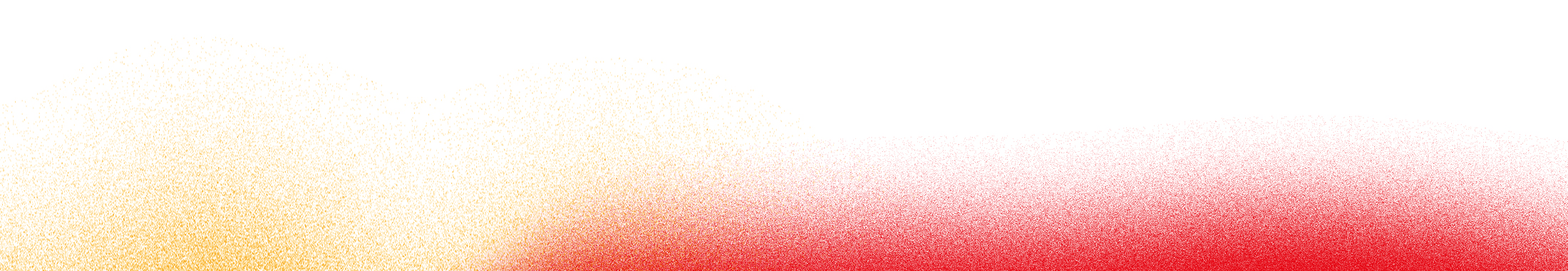A. Lenz, Village des Bois
A. Lenz
Village des Bois, après 1856
Huile sur toile
36 x 55 cm
MJ.1996.80
Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont
Murs en pierres sèches
Les murs de pierres sèches sont des éléments marquants du paysage de la chaîne jurassienne. Ils représentent également des milieux précieux pour de nombreux êtres vivants. Ils sont composés de pierres brutes qui sont superposées de manière à ce qu'elles forment un mur stable et solide, sans mortier. À l'origine, les pierres utilisées étaient généralement ramassées à proximité ou récoltées dans des petites carrières locales.
La construction d'un mur de pierres sèches nécessite un certain savoir-faire. En principe, la hauteur du mur représente le double de la largeur de ses fondations et sa base est plus large que son sommet. Plusieurs types de pierres sont nécessaires; elles doivent être disposées selon une technique particulière puisqu'aucune forme de ciment ou de mortier ne les soude. Les pierres sont prélevées dans la région, dans des couches géologiques particulières. Ces structures abritent également une grande diversité d'êtres vivants (p. ex. des reptiles, des insectes, des escargots, certaines plantes comme des mousses, des orpins ou des lichens).
Un mur contient des espèces différentes sur le côté exposé au sud (sec et chaud) et sur le côté nord (plus froid et humide). Il assure également la fonction de liaison entre différents biotopes et constitue un des éléments des projets de réseaux écologiques.
Les murs de pierres sèches sont menacés de disparition, car ils sont de plus en plus souvent laissés à l'abandon. Heureusement diverses associations œuvrent dans le but de maintenir et de reconstruire ces structures typiques du paysage jurassien.
Texte tiré de la brochure L’essentiel sur les pâturages boisés, réalisée par le Parc Naturel Régional du Doubs, 4e édition en 2020. Pour la commander, rendez-vous sur le site Internet du Parc.